
L’investissement public
Compte rendu de la Journée d’études « L’Investissement public » du 15 décembre 2023 à Sciences Po Paris, dans le cadre du séminaire Théorie et économie […]

Compte rendu de la Journée d’études « L’Investissement public » du 15 décembre 2023 à Sciences Po Paris, dans le cadre du séminaire Théorie et économie […]

Hubert KempfÉcole Normale Supérieure Paris Saclay, Université Paris Saclay, et OFCE L’union des marchés de capitaux est à l’agenda des dirigeants européens et de la […]
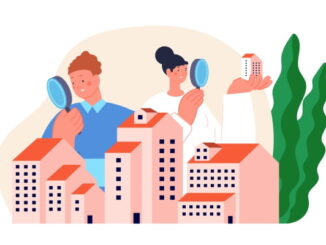
Gregory Verdugo, Université Paris-Saclay, Evry, et OFCE[1] En logeant près d’un ménage sur cinq en 2020, le logement social demeure une pièce centrale de la […]

Sébastien Bock, Aya Elewa, Sarah Guillou, Mauro Napoletano, Lionel Nesta, Evens Salies, Tania Treibich Depuis les premiers travaux de Robert Solow, on sait que la […]

Jérôme Creel, Fipaddict, Clara Leonard, Nicolas Leron et Juliette de Pierrebourg Comment sortir du dilemme entre épuisement planétaire et contraintes budgétaires dans lequel se trouvent […]

par Sarah Guillou Plus personne ne craint de prononcer son nom : la politique industrielle est bien de retour. Mais ce qui marque la politique industrielle […]

par Alexandre Tourbah (OFCE), Frédéric Reynès (OFCE-NEO-TNO), Meriem Hamdi-Cherif, Jinxue Hu (NEO), Gissela Landa et Paul Malliet Les politiques d’infrastructures constituent un levier essentiel des […]

par Xavier Ragot Le débat macroéconomique est actuellement très animé. Le changement de politique économique aux États-Unis après l’élection de Joe Biden suscite un débat […]

by A. Benramdane, S. Guillou, D. Harrich, and K. Yilmaz Economies have been dramatically affected by the pandemic of Covid-19 in 2020 (OFCE, 2020). In […]

par Mathieu Plane, Xavier Ragot, Francesco Saraceno Comparé aux autres pays de l’OCDE, le capital public en France est élevé ainsi que la qualité des […]
Copyright © 2024 | Thème WordPress par MH Themes