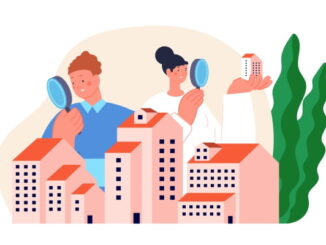
Projet de loi sur le logement abordable : vers des logements sociaux pour villes riches ?
Gregory Verdugo, Université Paris-Saclay, Evry, et OFCE[1] En logeant près d’un ménage sur cinq en 2020, le logement social demeure une pièce centrale de la […]








