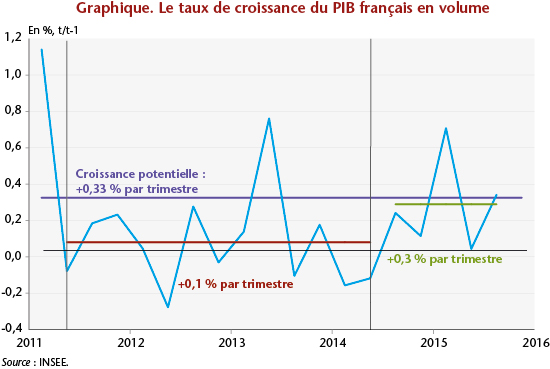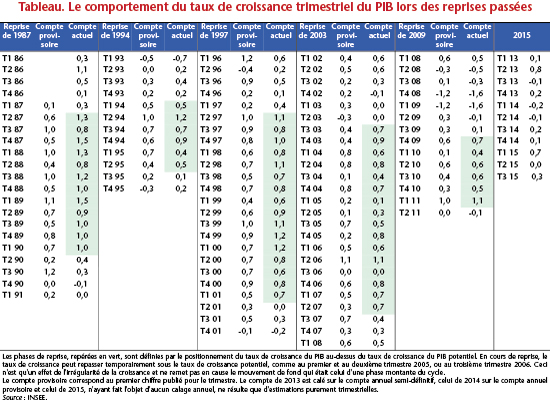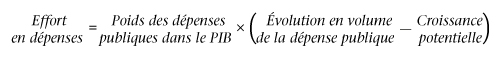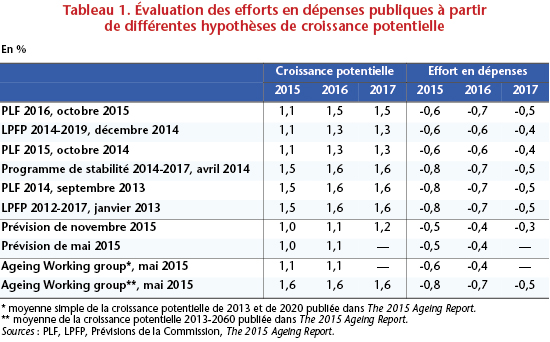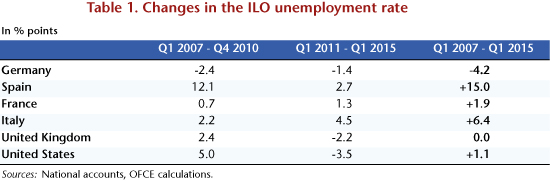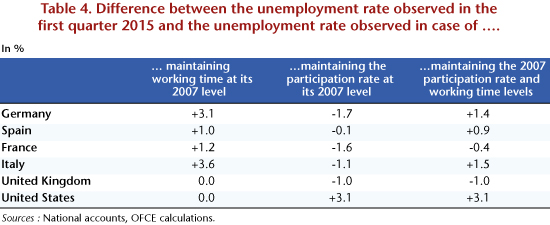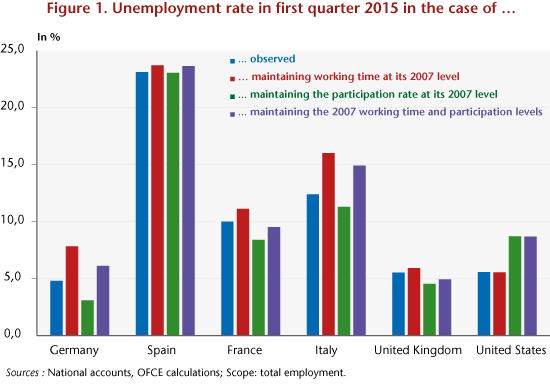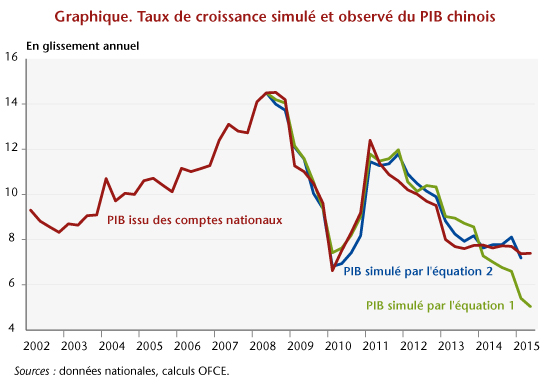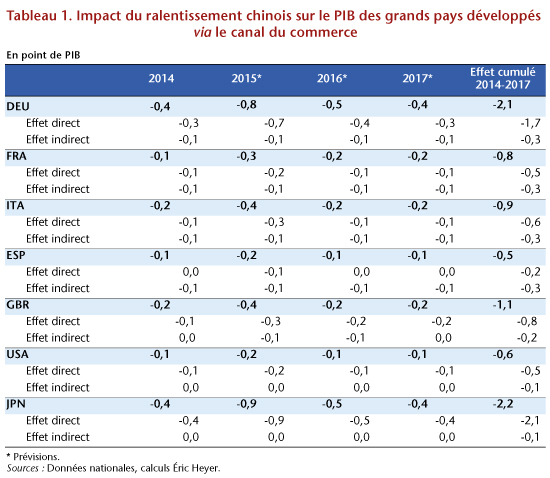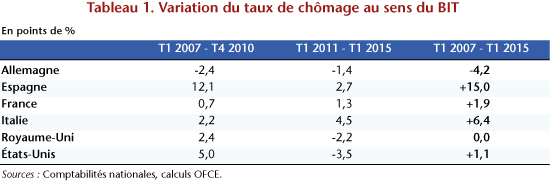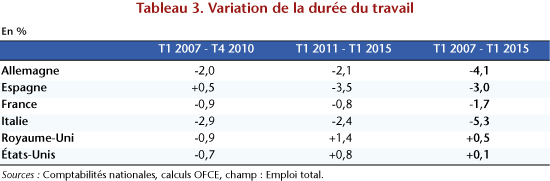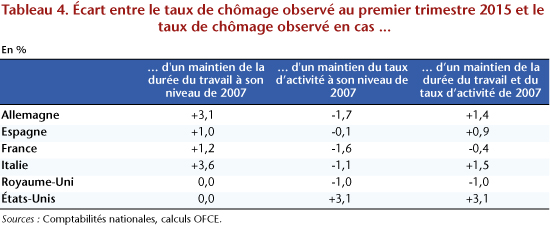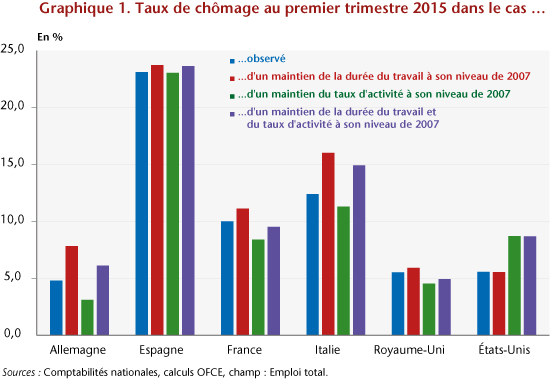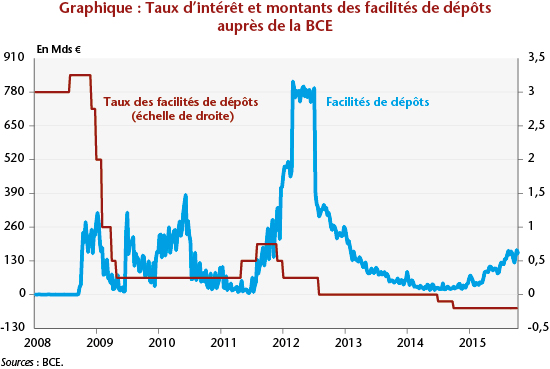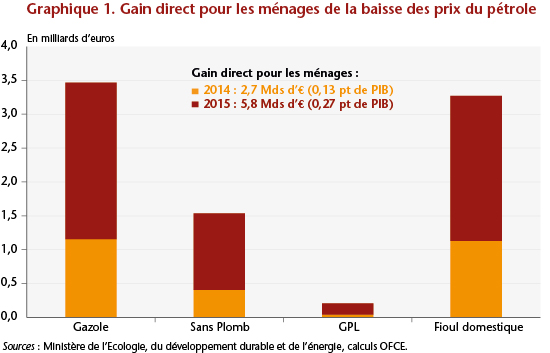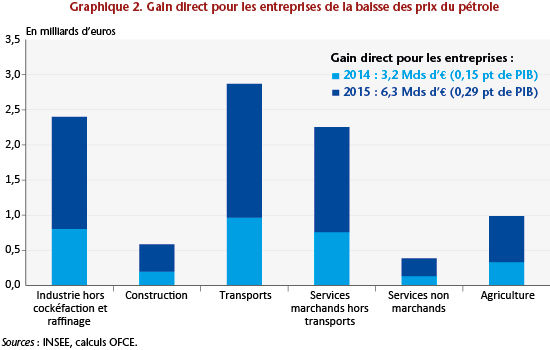Par Guillaume Allègre, Gérard Cornilleau, Éloi Laurent et Xavier Timbeau
A l’heure des élections régionales et de la création de nouvelles régions et de métropoles, un numéro de la Revue de l’OFCE (n° 143, novembre 2015) aborde les questions déterminantes pour les politiques publiques territoriales.
L’économie régionale met en jeu non pas un mais deux espaces : les régions et le cœur de celles-ci, les métropoles. L’attention à ces deux espaces, dont on peut dire qu’ils ont été les impensés du deuxième « acte » de la décentralisation en France, a largement déterminé les trois lois de la réforme régionale de 2014-2015. La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 affirme l’importance des métropoles dès son intitulé : « loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ». Elle crée la métropole du Grand Paris qui regroupera les communes de Paris et de la petite couronne à compter du 1er janvier 2016, la métropole de Lyon et celle d’Aix-Marseille-Provence, ainsi que neuf autres métropoles régionales dites de droit commun (Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Nice, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble). La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions fait quant à elle passer de 22 à 13 le nombre de régions également à compter du 1er janvier 2016. La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) parachève l’édifice en confiant de nouvelles compétences à ces nouvelles régions.
Si on voit bien l’influence de l’économie géographique et son souci d’efficience spatiale sur la réforme territoriale, on perçoit nettement moins dans les réformes envisagées les limites de celles-ci et la question pourtant centrale de l’égalité des territoires. C’est donc à l’aune de la double question de l’efficience et de l’équité qu’il convient d’interroger la nouvelle économie régionale française que dessine la réforme territoriale. Quelle relation entre la taille des zones d’emploi et leur performance économique et sociale ? Avec quels indicateurs doit-on mesurer le développement économique, social et environnemental des territoires ? Certaines organisations territoriales sont-elles plus efficaces que d’autres ? Les mesures favorisant l’égalité entre les territoires sont-elles un frein ou un accélérateur du développement économique ? Existe-t-il une taille optimale des régions ? Peut-on envisager une tension entre régions légales et régions réelles et/ou vécues ?
Quelle relation entre la taille des zones d’emploi et leur performance économique et sociale ?
Dans sa contribution, Jean-Claude Prager nous rappelle que la concentration spatiale des activités et la croissance économique sont deux phénomènes historiques difficiles à séparer. Il l’attribue à l’importance des effets d’agglomération. Cependant, la taille des villes s’accompagne également de coûts environnementaux et de congestion de plus en plus grands. Il n’y a donc pas de réponse générale à la taille optimale des villes dans la mesure où la qualité de la gouvernance joue un rôle déterminant dans l’équilibre entre les bénéfices et les coûts associés. Pour Laurent Davezies, la taille de la région et la qualité du fonctionnement des marchés sont des facteurs majeurs de croissance. La taille et la densité offrent en effet un meilleur appariement des offres et des demandes sur les différents marchés, notamment sur le marché du travail. L’efficacité des marchés urbains est tout de même conditionnée aux politiques publiques d’urbanisation et notamment à l’efficacité des systèmes de transports. A l’inverse, pour Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti, si les effets d’agglomération sont statistiquement significatifs, l’ampleur de ces effets est faible et les données présentent des limites. Pour les auteurs, il est hasardeux de justifier sur une base aussi fragile une politique de concentration de l’activité économique dans quelques métropoles.
Avec quels indicateurs doit-on mesurer le développement économique, social et environnemental des territoires ?
Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti critiquent l’utilisation du PIB régional par habitant, qui serait un très mauvais indicateur de performance des régions. Premièrement, c’est le PIB par emploi et non par habitant qui permet de mesurer la productivité apparente du travail. Deuxièmement, les auteurs soulignent que les différences de productivité apparente sont liées à des effets de composition et d’interdépendance. Par exemple, si l’Île-de-France est plus productive c’est parce qu’elle abrite les sièges sociaux et une part importante des très hautes rémunérations. Mais toutes les régions ne peuvent pas imiter cette stratégie. Laurent Davezies reconnaît que le concept de PIB territorialisé pose de nombreux problèmes conceptuels et statistiques mal résolus. Pourtant, il considère que celui calculé par l’INSEE est très proche de l’idée raisonnable que l’on peut se faire de la contribution de la région à la création de richesse nationale. Pour l’auteur, la surproductivité de l’Île-de-France n’est pas qu’un artefact statistique. Il souligne ainsi que la part de la région dans les rémunérations versées (32,9%) et dans le PIB marchand (37%) est même supérieure à la part dans le PIB national (30,5%).
Dans un article retraçant les mutations économiques du Nord-Pas-de-Calais, Grégory Marlier, Thomas Dallery et Nathalie Chusseau proposent de compléter le PIB régional par des indicateurs alternatifs d’inégalités territoriales et de développement humain (IDH2). Ce dernier indicateur qui reprend la santé, l’éducation et le niveau de vie comme dimensions, place le Nord-Pas-de-Calais en dernière position des régions françaises. La déclinaison communale de l’indicateur de développement humain (IDH4) met en évidence des contrastes importants à l’échelle infrarégionale.
Dans une contribution sur les stratégies de développement régional dans l’OCDE, Joaquim Oliveira Martins et Karen Maguire présentent un ensemble d’indicateurs proposés par l’OCDE en 2014 pour mesurer le bien-être régional. Ces indicateurs capturent neuf dimensions du bien-être : revenu, emploi, logement, santé, éducation et compétences, qualité de l’environnement, sécurité personnelle, engagement civique et accès aux services.
Certaines organisations territoriales sont-elles plus efficaces que d’autres ?
Selon Joaquim Oliveira Martins et Karen Maguire, les études récentes de l’OCDE ont montré qu’une fragmentation des gouvernements municipaux peut avoir des effets négatifs sur la productivité des régions, notamment dans les zones métropolitaines. Les auteurs soulignent que l’on compte environ 1 400 collectivités locales dans l’agglomération de Paris. Or, un doublement des gouvernements locaux peut réduire de presque autant l’avantage en termes d’économies d’agglomération du doublement de la taille d’une ville. Laurent Davezies critique lui aussi la fragmentation communale et appelle à plus de politiques urbaines intégrées. Il souligne que la dernière loi sur l’organisation territoriale de la République va dans ce sens.
Pour Jean-Claude Prager, la qualité de la gouvernance des régions et des métropoles est importante pour leur prospérité mais elle ne peut cependant pas se réduire à des seuls critères formels. Elle dépend de la personnalité des dirigeants et de leurs capacités à mettre en œuvre des stratégies de différenciation économique des territoires.
Jacques Lévy critique pour sa part le faible poids des budgets régionaux (en moyenne, un peu plus de 1% du PIB), qui ne donne pas aux régions les moyens de gérer leur développement.
Les mesures favorisant l’égalité entre les territoires sont-elles un frein ou un accélérateur du développement économique ?
Selon Jean-Claude Prager, le bilan des politiques de rééquilibrage régional est controversé, notamment parce qu’elles ne font pas la différence entre les individus concernés et les territoires administratifs. Selon l’auteur, le soutien financier aux régions moins riches peut avoir pour effet principal de faire bénéficier d’effets d’aubaine les personnes les mieux dotées de ces régions, celles dont la capacité de captation des subventions publiques est forte, sans nécessairement profiter principalement aux plus démunis de leur région. L’auteur conclut que l’efficacité et l’égalité des chances sont mieux assurées avec le développement du capital humain.
Cette stratégie peut être rendue difficile car, comme le soulignent Arnaud Degorre, Pierre Girard et Roger Rabier, les espaces métropolitains ont tendance à capter les ressources rares et notamment les travailleurs qualifiés qui sont également les plus mobiles. Au jeu des migrations résidentielles, la vaste majorité des territoires enregistrent des départs des plus qualifiés, au profit en premier lieu de l’agglomération parisienne, mais aussi des métropoles en région, dont Toulouse, Grenoble, Lyon et, dans une moindre mesure, Montpellier et Lille.
Existe-t-il une taille optimale des régions ? Peut-on envisager une tension entre régions légales et régions réelles et/ou vécues ?
Jacques Lévy revient sur les quatre erreurs de la réforme régionale. C’est une action top-down technocratique qui ignore les habitants. Elle découpe le grand (la région) avant le petit (le local). Elle définit des frontières avant de définir des compétences. Enfin, elle évite de supprimer le Conseil de département. L’auteur avance une proposition alternative de carte régionale rapprochant les régions vécues des régions administratives. Il privilégie une démarche bottom-up et définit en premier lieu 771 pays de taille très variable (de 3 000 à 12 millions d’habitants) puis propose une nouvelle carte des régions en analysant les interconnexions entre pays. Les régions n’ont pas toutes la même taille car elles sont le produit d’équilibres différenciés entre ressources objectives (démographie, formation, système productif, niveau d’urbanisation) et ressources subjectives (identification, mémoire, projet). C’est ainsi que pour l’auteur la Corse (300 000 habitants) et l’ensemble du Bassin parisien (22,2 millions d’habitants) sont tous deux légitimes comme région.