
L’Europe de la défense
Compte rendu du séminaire « Théorie et économie politique de l’Europe », Cevipof-OFCE, séance n° 8 du 18 novembre 2022 Intervenants : Jean BELIN (Chaire Économie de la défense), […]

Compte rendu du séminaire « Théorie et économie politique de l’Europe », Cevipof-OFCE, séance n° 8 du 18 novembre 2022 Intervenants : Jean BELIN (Chaire Économie de la défense), […]

par Éloi Laurent La vigueur du débat actuel autour de la réforme des retraites tient à la centralité de deux réalités imbriquées de la vie […]

par Sandrine Levasseur Lancé en décembre 2019, le Green Deal ou Pacte Vert formule des ambitions importantes en matière climatique et environnementale pour l’Union européenne […]

par Christophe Blot Pour la première fois depuis le mois de juin 2021, l’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé, a baissé […]

par Vincent Touzé En 2023, la France s’apprête à adopter une nouvelle réforme visant à restaurer l’équilibre financier du système de retraite. Le gouvernement Borne […]

par Maxime Parodi, Hélène Périvier, Fabrice Larat

par Catherine Mathieu Les instituts de conjoncture membres de l’AIECE (Association d’Instituts Européens de Conjoncture Économique[1]) se sont réunis à Bruxelles pour leur réunion d’automne […]

par Raul Sampognaro L’invasion de l’Ukraine lancée par la Russie le 24 février 2022[1] a constitué un choc majeur pour l’économie européenne, déjà mise à […]

par Elliot Aurissergues L’année 2022 a été marquée par une très forte poussée inflationniste aux États-Unis et en zone euro. Fin octobre, le taux d’inflation […]
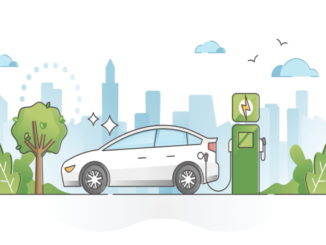
par Sarah GUILLOU L’Inflation Reduction Act (IRA) a été voté par le Congrès américain le 22 août 2022. Il agite aujourd’hui les gouvernements européens qui […]
Copyright © 2025 | Thème WordPress par MH Themes