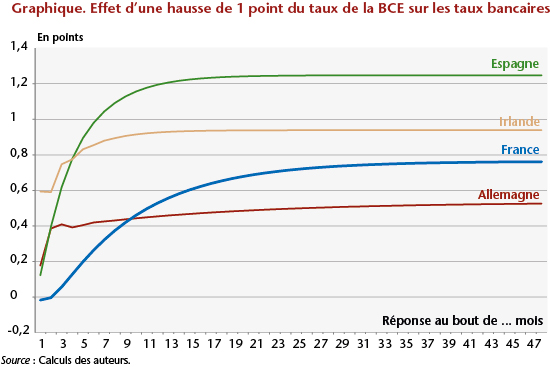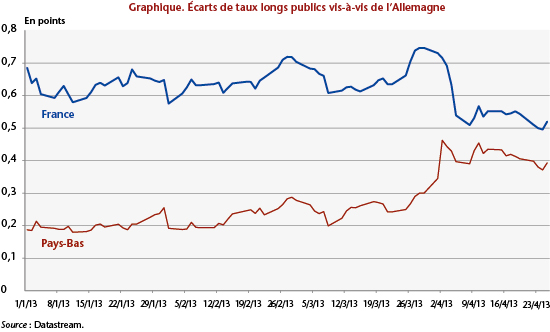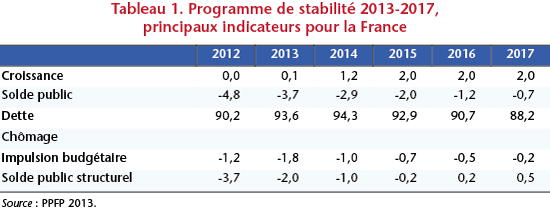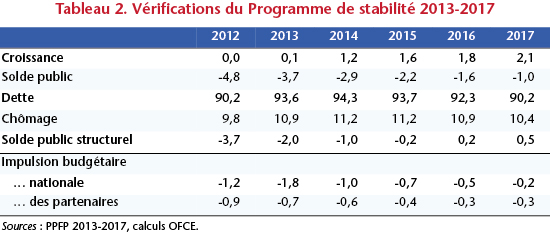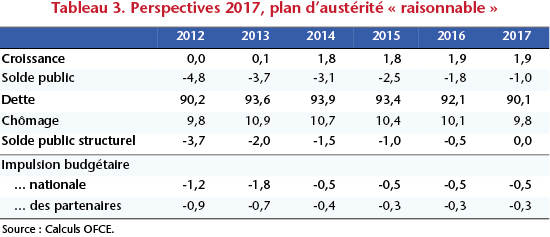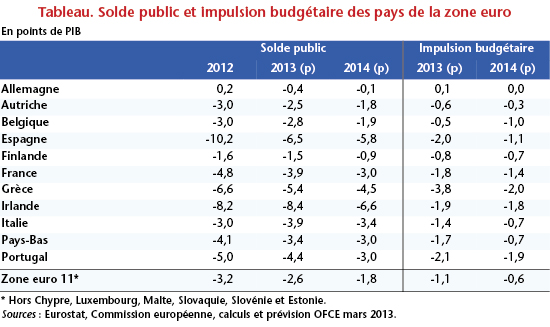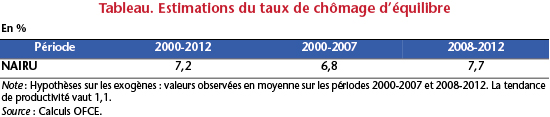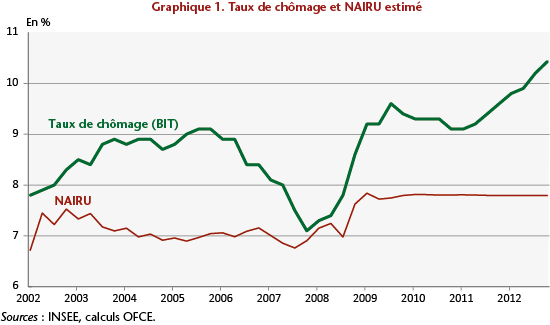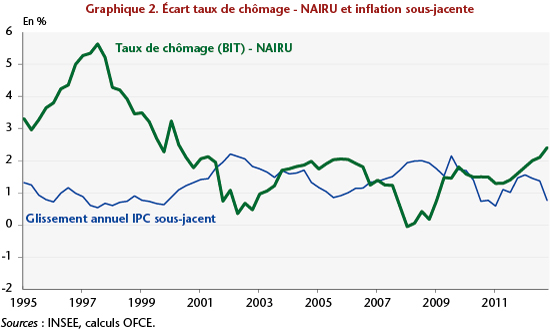par Jean-Luc Gaffard et Francesco Vona
Les accords de Bretton Woods avaient pour objectif de concilier un pouvoir domestique de régulation macroéconomique fondé sur la mise en œuvre de stabilisateurs internes et la recherche de la justice sociale avec une nécessaire discipline internationale susceptible de garantir une libéralisation progressive du commerce, source de croissance (Rodrik 2011). Ils y sont parvenus. Dans un contexte devenu très différent, cet objectif est toujours d’actualité. La forme que peut prendre, aujourd’hui, la discipline nécessaire pourrait bien s’inspirer de Keynes qui avait proposé, en vain, l’adoption d’une sorte de stabilisateur automatique de la demande globale. L’idée est que pour échapper à un mauvais équilibre fait de demande faible et de dettes élevées, réabsorber les déséquilibres globaux grâce à ce type de stabilisateur serait le meilleur moyen de relancer la demande, à la fois directement en laissant les pays en surplus dépenser plus et, indirectement, en réduisant les inégalités.
Le déficit structurel de demande globale représente sans conteste la contrainte majeure qui pèse sur la sortie de la grande récession. Une demande mondiale atone apparaît comme la résultante de deux facteurs tout à fait indépendants, une contrainte et un choix politique. Le choix est celui de ces pays, spécialement les pays émergents auxquels il faut ajouter l’Allemagne, qui ont bâti leur enrichissement sur une croissance entraînée par l’exportation en utilisant un mix de modération salariale et de stratégies efficaces de conquête des marchés. La contrainte est celle exercée par la dette publique qui affecte la possibilité d’expansion de la demande dans la majorité des pays développés. Dans la mesure où ces pays doivent appliquer des politiques budgétaires restrictives afin de prévenir le risque de défaut, leur seule chance de soutenir la demande repose sur la redistribution des revenus en faveur des ménages pauvres dont la propension à consommer est plus grande.
Le débat actuel sur cette question est au mieux trompeur, oscillant entre les habituels Charybde et Scylla, entre plus ou moins d’intervention de l’Etat. D’un point de vue keynésien standard, le goulot d’étranglement de la demande mondiale est la conséquence des politiques néo-libérales, aggravées en Europe en raison de l’opposition des pays du Nord à la mise en œuvre de programmes publics par l’Union européenne, éventuellement financés grâce à l’émission d’obligations en euros. D’un point de vue orthodoxe, développé par des économistes convaincus de l’existence de mécanismes de ruissellement (augmenter la richesse de quelques-uns finit par profiter à tous), la crise constitue une opportunité pour éliminer les dernières barrières à une complète libéralisation des marchés de biens et du travail. Ces barrières sont supposées empêcher les économies de l’UE d’accroître leur compétitivité vis-à-vis de leurs nouveaux concurrents, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Alors que les keynésiens sont singulièrement optimistes dans leur croyance que davantage de dépenses publiques réussira à assurer un nouveau départ à des économies affaiblies, l’économie orthodoxe néglige par hypothèse le problème de la demande globale. Elle ignore qu’une course à la compétitivité basée sur davantage de modération salariale et de coupes dans les dépenses de l’Etat providence ne ferait qu’amplifier la contrainte de demande globale.
Il est bien documenté qu’au cours des trente dernières années, les salaires réels et les conditions de vie des travailleurs de basse et moyenne qualifications se sont substantiellement dégradés, alors que les profits et, plus généralement, les gains des 1% de ménages les plus riches ont augmenté de manière impressionnante (Piketty and Saez 2006, Eckstein and Nagypál 2004, OECD 2011). Le creusement des écarts de revenus a été particulièrement important aux Etats-Unis et dans les pays Anglo-Saxons où des marchés du travail dérégulés ont permis des ajustements à la baisse des salaires. Il a aussi affecté les économies européennes sous d’autres formes, des taux de chômage structurels et des parts de profit plus élevés (Krugman 1994). La diminution excessive du salaire médian en regard de la productivité moyenne a créé un coin entre la demande qui est plus sensible aux variations de salaires qu’aux variations des opportunités de profit, et l’offre pour laquelle c’est le contraire. La mondialisation joue un rôle clé dans l’accroissement des inégalités entre profits et salaires dans la mesure où l’accroissement de la mobilité du capital ne s’est pas accompagné, en parallèle, d’un accroissement de la mobilité internationale du travail (Stiglitz 2012). Seul le jeu conjoint d’une dette accrue (à la fois publique et privée) et des gains de productivité dus aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ont empêché le déficit de demande de se manifester plus tôt en relation avec l’effet perturbateur d’une excessive inégalité (voir Stiglitz 2012, Fitoussi and Saraceno 2011, Patriarca and Vona 2013). Les déséquilibres globaux ont joué un rôle clé dans le maintien d’un niveau élevé de demande globale dès lors que l’épargne constituée dans les pays dont les comptes courants sont excédentaires (la Chine) a été prêtée aux ménages et gouvernements des pays déficitaires (les Etats-Unis). En outre, en atténuant les effets d’inégalités excessives, les déséquilibres globaux font que la pression politique en faveur d’une redistribution demeure sous contrôle. Mais, comme nous l’avons constaté, ils ont été la source d’une instabilité macroéconomique. L’excès d’épargne en Chine a créé une masse de liquidités en quête d’opportunités d’investissement qui a augmenté la probabilité de formation de bulles des prix des actifs, notamment en présence d’un secteur financier inadéquat et surdimensionné (Corden 2011).
En dehors de toute considération éthique, la préoccupation relative aux effets d’une inégalité croissante dans les économies occidentales n’aurait guère d’importance au regard de la croissance mondiale, si la demande plus faible là était compensée par une demande croissante dans les pays exportateurs comme la Chine (ou l’Allemagne). Malheureusement, il n’y a pas compensation et il n’est pas prévu qu’elle prenne place rapidement pour au moins deux raisons.
En premier lieu, les oligarchies des pays émergents (spécialement la Chine) ont trouvé commode de soutenir la demande indirectement, plutôt que par le canal d’une hausse des salaires proportionnelle aux gains de productivité, en investissant les larges surplus de la balance courante sur le marché financier américain et, ce faisant, en finançant les consommateurs américains. Le fait que les inégalités aient également augmenté en Chine depuis que les réformes favorables au marché ont été engagées, vient à l’appui de cet argument. En particulier, l’inégalité entre les parts des facteurs, c’est-à-dire entre profits et salaires, s’est accrue substantiellement depuis 1995, avec une part des salaires qui a diminué entre 7.2% et 12.5% suivant la définition comptable retenue (Bai and Qian 2010). Le problème vient, évidemment, de ce que les déséquilibres mondiaux ont été à l’origine de la crise financière actuelle.
Deuxièmement, une comparaison historique des épisodes de rattrapage peut aider à faire la lumière sur l’origine de l’abondement nécessaire de la demande mondiale. Le rattrapage économique par l’Allemagne et les Etats-Unis du Royaume-Uni à partir de la deuxième moitié du 19ème siècle a été rapidement suivi par la convergence des niveaux de vie et des salaires (Williamson, 1998). Aujourd’hui, le rattrapage économique de la Chine est beaucoup plus lent en termes de convergence des salaires et des conditions de vie. A titre d’exemple, le PIB de la Chine par habitant est passé de 5,7% à 17,2% du PIB américain par habitant entre 1995 et 2010 (source: Penn World Tables), tandis que le coût horaire du travail, également en augmentation, n’a atteint que 4,2% de celui des États-Unis en 2008 (source: Bureau of Labor Statistics). Cet écart entre le PIB par habitant et le coût unitaire du travail en Chine montre clairement que le rattrapage en termes de conditions de vie des travailleurs est beaucoup plus lent que le rattrapage en termes de taux de croissance. L’écart est encore plus frappant quand le pays de référence, les Etats-Unis, est lui-même caractérisé par un niveau élevé d’inégalité.
Les raisons de cette lente convergence des salaires méritent de plus amples investigations et ont probablement à voir avec les facteurs affectant les changements institutionnels qui favorisent la redistribution des profits vers les salaires, y compris la culture et la progressivité de l’impôt (Piketty et Qian 2009), dans les pays en phase de rattrapage. Certes, la taille de la population chinoise par rapport à la population mondiale n’a pas aidé à établir ces changements institutionnels. Sur la base de simples hypothèses de la théorie standard de la négociation, le pouvoir de négociation dépend de l’option extérieure, laquelle est limitée pour les travailleurs par l’existence d’une grande «armée de réserve» prête à travailler pour des salaires extrêmement bas. On peut alors affirmer que plus grande est l’armée de réserve, plus de temps il faut pour réduire la pression à la baisse sur les salaires des travailleurs dans la partie avancée de l’économie. De fait, la convergence des salaires a été beaucoup plus rapide dans les précédents épisodes de rattrapage dès lors que la contrainte du travail est devenue plus forte, plus rapidement en raison de la petite taille de la population, permettant aux travailleurs de lutter pour de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. En un mot, une trop grande armée de réserve empêche les salaires d’augmenter suffisamment au regard de la productivité et les réformes démocratiques de décoller en Chine, créant ainsi un écart entre le moment de la croissance économique et celui des réformes politiques, nécessaires pour rééquilibrer la demande et l’offre.
Non seulement la lente convergence en termes de salaires des pays en phase de rattrapage provoque des déséquilibres mondiaux persistants entre la demande et l’offre, mais c’est aussi la raison essentielle des obstacles rencontrés pour réduire les inégalités dans les pays occidentaux du fait de la pression concurrentielle ainsi exercée. En premier lieu, la mise en œuvre de politiques de redistribution augmentant les salaires réels est susceptible de réduire encore davantage la compétitivité et de provoquer un flux substantiel d’investissements à l’étranger. En second lieu, la délocalisation de la production à l’étranger peut avoir forcé les travailleurs à accepter des salaires plus bas, un effet difficile à corréler empiriquement avec des mesures approchées de la mondialisation telles que le commerce ou les investissements extérieurs. Cependant, alors que les analyses empiriques des 30 dernières années du 20e siècle s’accordent à dire que la mondialisation n’a pas été pas le principal facteur
d’augmentation de l’inégalité, des études récentes indiquent que: (i) l’externalisation a eu un impact négatif sur les salaires des qualifications moyennes ou faibles et les niveaux d’emploi correspondants dans les pays développés, en particulier dans la dernière décennie (Firpo, Fortin et Lemieux 2011), (ii) l’effet du commerce sur l’inégalité a peut être été sous-estimé du fait de la fragmentation de la production (Krugman 2008).
Les déséquilibres mondiaux sont également susceptibles de créer des obstacles aux politiques visant à réduire les inégalités. Un secteur financier surdimensionné a contribué à augmenter les revenus du 1% les plus riches de la population et donc leur pouvoir de lobbying. Cela a permis à ces super-riches d’influencer fortement les décisions politiques qui ont rendu leurs rentes plus élevées, notamment grâce à une réduction massive de la progressivité de l’impôt (Fitoussi et Saraceno 2012) et d’autres circuits opaques (par exemple, les failles fiscales, Stiglitz 2012). Maintenant, ce lobby des super-riches rend extrêmement difficile de limiter le pouvoir de la finance et de restaurer des taux d’imposition plus équitables des rentes et autres hauts revenus.
Comment éviter l’impasse engendrée par les déséquilibres mondiaux et la pression mondiale pour la modération salariale? Y a-t-il dans le système tel qu’il est des forces endogènes qui finiront par réduire les déséquilibres mondiaux et les inégalités?
La première option est d’attendre des réformes en Chine. Les politiciens dans les pays occidentaux peuvent espérer en une accélération de ce processus qui va conduire à une augmentation parallèle des salaires réels et, partant, de la demande mondiale. Ce serait la solution de marché idéale, mais il est peu probable qu’elle se produise à court et à moyen terme. Une deuxième possibilité consistera en une dépréciation à grande échelle des devises des économies occidentales: dollar, euro et yen. Toutefois, une telle politique est susceptible de créer une spirale de dépréciation, ce qui augmente aussi l’incertitude de l’investissement. La persuasion est peu probable de convaincre les politiciens chinois de ne pas dévaluer le yuan dans la mesure où leurs avoirs en dollars et en euros vont se déprécier considérablement. Une troisième solution, protectionniste, n’est pas convaincante du tout car elle est susceptible de déclencher une spirale de représailles ouvrant la voie à des guerres globales. Interactions politiques indirectes et mondiales sont en jeu ici: les partis politiques nationalistes et les politiques protectionnistes associées risquent de devenir d’autant plus populaires que le calendrier des réformes chinoises est trop lent et donc le processus d’ajustement douloureux dans le moyen terme. Une quatrième solution est de recourir à une vieille idée de John Maynard Keynes sur les «stabilisateurs automatiques mondiaux». Dans le contexte de l’après-Seconde Guerre mondiale, Keynes a proposé une institution internationale, l’ «Union de compensation internationale» (ICU), pour résorber à la fois les excédents et les déficits commerciaux, considéré comme aussi inquiétants les uns que les autres (A. Bramucci 2012). En particulier, les excédents commerciaux persistants étaient considérés comme une source potentielle de pénurie à long terme de la demande mondiale. L’idée principale était de coordonner à travers l’ICU à la fois les réévaluations et l’expansion de la demande dans les pays en excédent, et les dévaluations et le contrôle des mouvements de capitaux dans les pays en déficit. Une telle institution irait dans la bonne direction pour aider à résorber les déséquilibres mondiaux, mais manquerait du pouvoir nécessaire pour que les ajustements nécessaires soient effectivement mis en place.
La combinaison d’une règle globale pour l’ajustement des salaires avec des sanctions de l’OMC peut constituer une façon plus intelligente et fiable de relancer la demande mondiale. La première partie de la proposition consisterait à lier la croissance des salaires réels non seulement à la croissance de la productivité, tel que proposé par A. Watt (2011), mais aussi à l’excédent commercial. Conditionnée au niveau de développement du pays (de sorte que les ajustements réglementaires doivent tenir compte du niveau initial du PIB par habitant, évidemment ajusté pour les PPP), cette proposition signifierait que les pays qui connaissent des croissances à moyen terme à la fois de la productivité et de l’excédent commercial devraient augmenter les salaires réels. Sinon, d’autres pays pourraient augmenter les tarifs sur les produits exportés par les pays qui ne respectent pas la règle. La capacité effective de mettre en œuvre cette règle peut être renforcée en donnant aux organisations syndicales, globales ou locales, et aux ONG le pouvoir de contrôler les situations spécifiques où la règle n’est pas respectée, c’est à dire la zone spéciale axée sur l’exportation en Chine, où les normes du travail sont particulièrement faibles. Dans le cas des déficits commerciaux, le pays pourrait être invité à suivre une modération des salaires réels et à mettre sous contrôle le déficit public. Dans un tel contexte, ces politiques restrictives pourraient avoir des effets néfastes limités sur la croissance en raison de l’augmentation de la demande extérieure qui fait suite à la hausse des salaires dans les pays exportateurs nets. La proposition aurait aussi un effet positif en réduisant le niveau global des inégalités fonctionnelles dans le monde entier, et en restaurant une répartition plus équilibrée entre salaires et profits.
Dans l’ensemble, la coordination de l’offre et la demande mondiale serait restaurée à l’aide d’un stabilisateur automatique simple qui neutraliserait la tentation protectionniste et, en même temps, relâcherait les contraintes qui empêchent les politiques de réduction des inégalités d’ être approuvées dans les pays occidentaux.
Références :
- Bai, C., Qian, Z., 2010, “The factor income distribution in China: 1978-2007”, China Economic Review, vol. 21(4), 650-670.
- Bramucci, A., 2012, “Gli Squilibri Europei e la Lezione di Keynes”, sbilanciamoci.info.
- Corden, W., 2011, “Global Imbalances and the Paradox of Thrift”, Policy Insight No.54, Centre for Economic Policy
Research (CEPR).
- Eckstein, Z., Nagypál, É., 2004. “The evolution of U.S. earnings inequality: 1961-2002“, Quarterly Review, Federal Reserve Bank of Minneapolis, issue Dec, 10-29.
- Firpo, S., Fortin, N., Lemieux, T., 2011, “Occupational Tasks and Changes in the Wage Structure,” IZA Discussion Papers
5542, Institute for the Study of Labor (IZA).
- Fitoussi, J.-P., Saraceno, F., 2011, “Inequality, the Crisis and After,” Rivista di Politica Economica, issue 1, pages 9-27.
- Krugman, P., 1994, “Past and prospective causes of high unemployment,” Proceedings,
Federal Reserve Bank of Kansas City, issue Jan, 49-98.
- Krugman, P., 2008, “Trade and Wages, Reconsidered”, Brookings Papers on Economic Activity, vol. 39(1), 103-154.
- OECD (2011), Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising www.oecd.org/els/social/inequality.
- Ottaviano, G., Peri, G., Wright, G., 2010, “Immigration, Offshoring and American Jobs”, CEPR Discussion Paper N8078.
- Patriarca, F., Vona, F., 2013, “Structural Change and the Income Distribution: an inverted-U relationship”, Journal of Economic Dynamics and Control forthcoming.
- Piketty, T., Qian, N., 2009, “Income Inequality and Progressive Income Taxation in China and India, 1986-2015“,
American Economic Journal: Applied Economics, vol. 1(2), 53-63.
- Piketty, T., Saez, E., 2006, “The Evolution of Top Incomes: A Historical and International Perspective“, American Economic Review, vol. 96(2), 200-205.
- Rodrik D., 2011, The Paradox of Productivity, New York: Norton & Cie.
- Stiglitz, J., 2012, The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future, W.W. Norton & Company.
- Watt, A., 2012, La crisi europea e la dinamica dei salari. La rotta d’Europa, 1.
L’economia. Sbilanciamoci!, sbilibri, 2.
- Williamson, J. 1998. Globalization and the Labour Market: Using history to inform policy. in: Aghion, P., Williamson, J. ‘Growth inequality and Globalization: Theory, History and Policy’, Cambridge University Press.