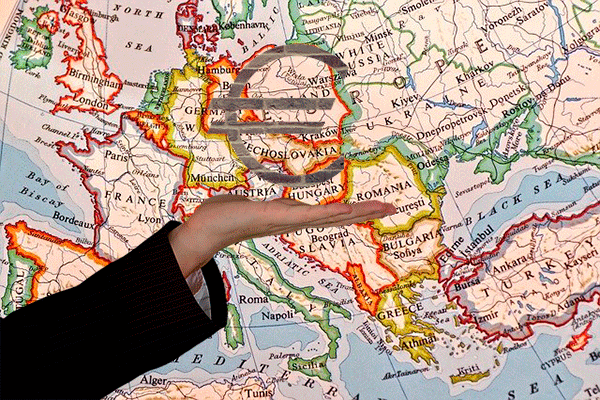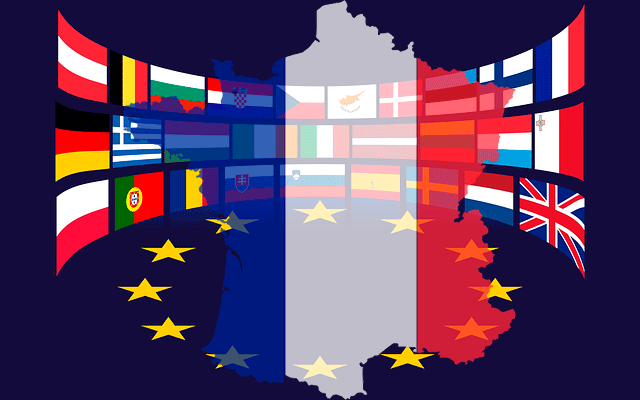Compte rendu du séminaire « Théorie et économie politique de l’Europe », Cevipof-OFCE, séance 2 – 11 février 2022
Intervenants : Olivier COSTA (Cevipof), Francesco MARTUCCI (Université Paris 2) et Xavier RAGOT (OFCE) Plan de relance européen et gouvernance économique de l’UE Le séminaire « Théorie […]