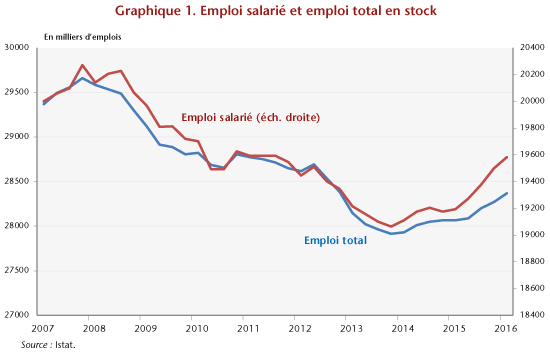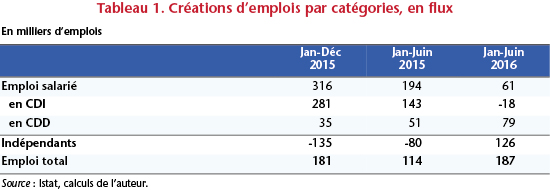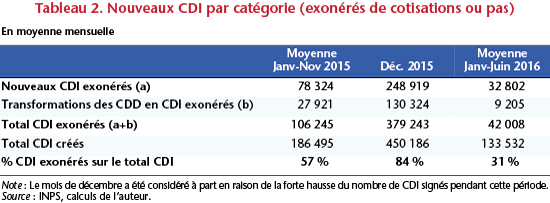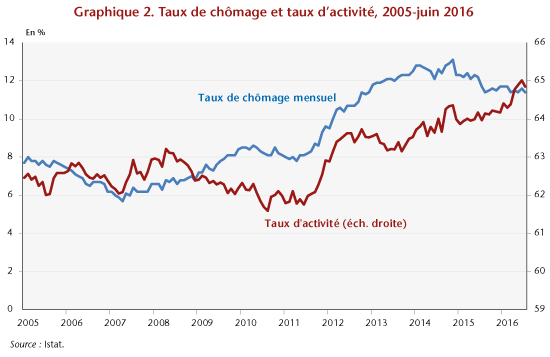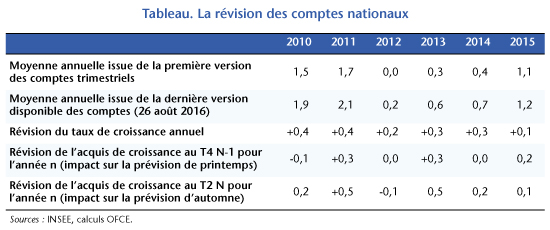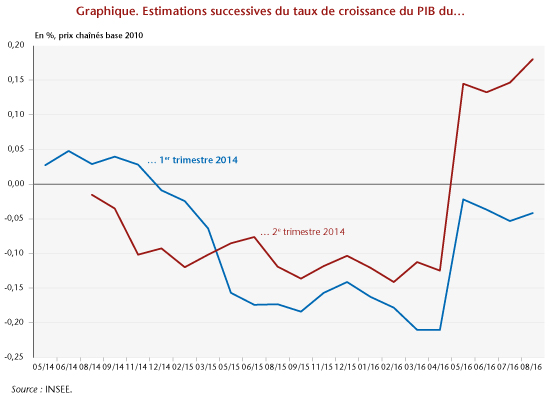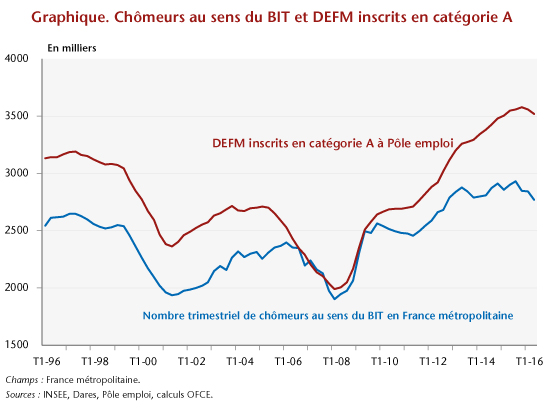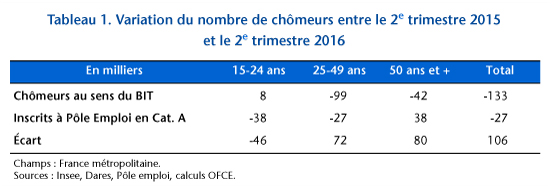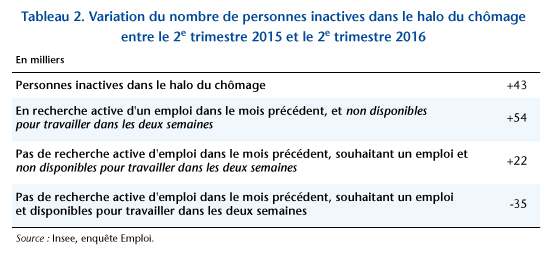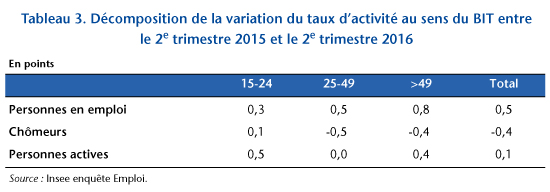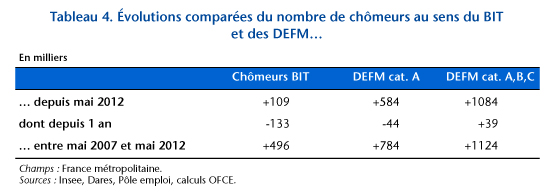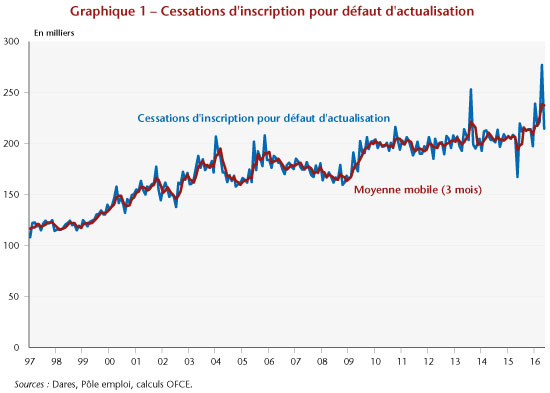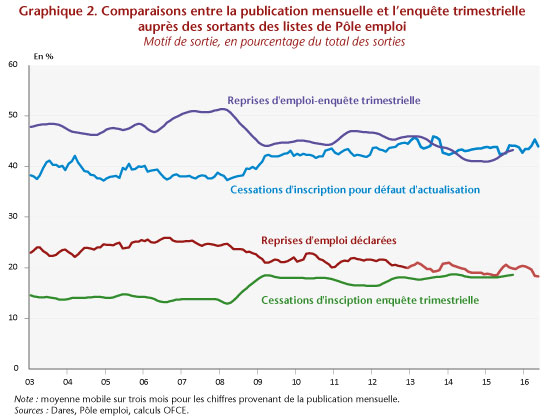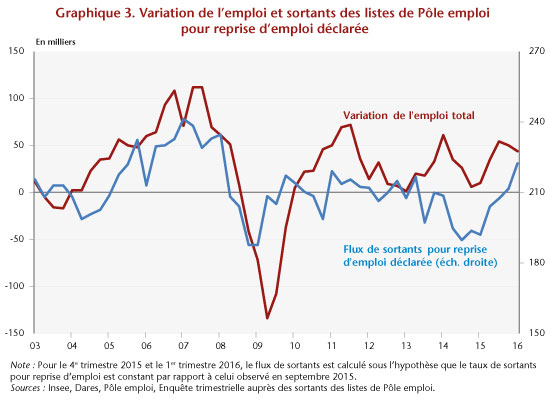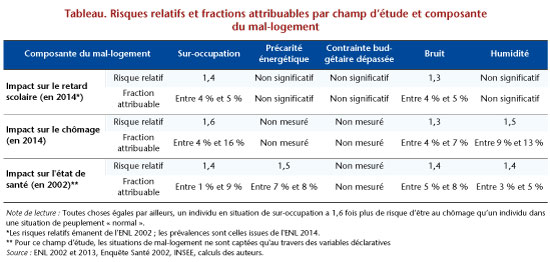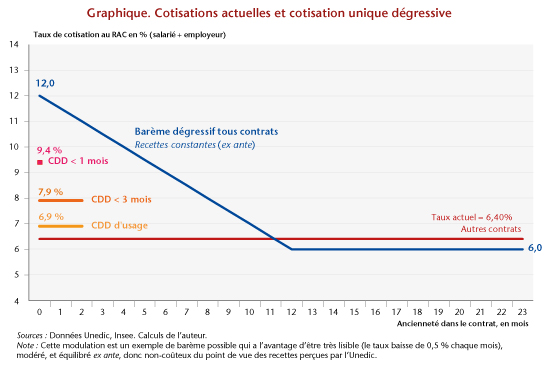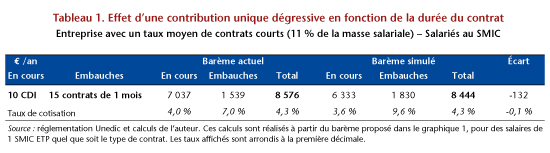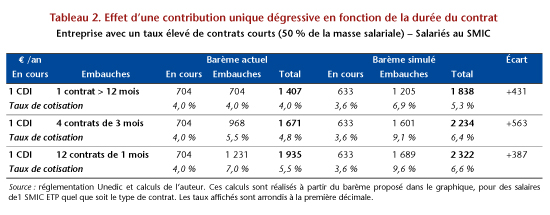Par Catherine Mathieu et Henri Sterdyniak
Le vote britannique pour une sortie de l’UE accentue la crise politique tant en Europe que dans beaucoup de pays européens. La sortie de l’Europe devient une alternative possible pour les peuples européens, ce qui peut encourager les partis souverainistes. Mécaniquement, le départ du Royaume-Uni augmente le poids du couple franco-allemand, ce qui peut déstabiliser l’Europe. Si l’Ecosse quitte le Royaume-Uni pour adhérer à l’UE, des mouvements indépendantistes d’autres régions (Catalogne, Corse, ..) pourraient demander une évolution similaire. Mais la fragilité de l’Europe provient aussi de l’échec de la stratégie « discipline budgétaire/réformes structurelles ».
Le départ du Royaume-Uni, farouche partisan du libéralisme économique, hostile à toute augmentation du budget européen comme à tout accroissement des pouvoirs des institutions européennes, comme à l’Europe sociale pourrait modifier la donne dans les débats européens, mais certains pays de l’Est, les Pays-Bas et l’Allemagne ont toujours eu la même position que le Royaume-Uni. Il ne suffira pas, à lui seul, à provoquer un tournant dans les politiques européennes. Par contre, la libéralisation des services et du secteur financier, que le Royaume-Uni impulse aujourd’hui, pourrait être ralentie. Le Commissaire britannique Jonathan Hill, responsable des services financiers et des marchés de capitaux devra être rapidement remplacé. Se posera la question délicate des fonctionnaires européens britanniques qui, en tout état de cause, ne pourront plus occuper de postes de responsabilité.
Il ouvrira aussi une période d’incertitude économique et financière. Mais il ne faut pas donner trop d’importance aux réactions des marchés financiers, qui n’aiment pas l’incertitude et sont de toute façon très volatils. La livre a certes rapidement perdu 10% par rapport à l’euro, mais elle était sans doute surévaluée, comme en témoigne le déficit courant britannique de l’ordre de 6,5% de son PIB en 2015.
Selon l’article 50 de la Constitution européenne, un pays qui décide de quitter l’Union doit négocier un accord de retrait, qui fixe la date de sortie[1]. Sinon, au bout de deux ans, le pays est automatiquement en dehors de l’Union. La négociation sera délicate ; elle portera obligatoirement sur l’ensemble des dossiers. Durant cette période, le Royaume-Uni restera dans l’UE. Les pays européens devront choisir entre deux attitudes. L’attitude compréhensive serait de signer rapidement un Traité de libre-échange, se donnant comme objectif de maintenir les relations commerciales et financières avec le Royaume-Uni, en tant que partenaire privilégié de l’Europe. Cela minimiserait les conséquences économiques du Brexit pour l’UE comme pour le Royaume-Uni. Toutefois, il paraît difficile que le Royaume-Uni puisse à la fois jouir d’une liberté totale pour son organisation économique et d’une ouverture totale des marchés européens. Le Royaume-Uni ne devrait pas bénéficier de conditions plus favorables que celles des membres actuels de l’AELE (Norvège, Islande, Liechtenstein) ou de la Suisse ; il devrait sans doute comme eux intégrer la législation du marché unique (en particulier pour la libre circulation des personnes) et contribuer au budget européen. Se poseraient très vite la question de normes, celle du passeport européen des institutions financières (ce passeport est aujourd’hui accordé aux pays de l’AELE, mais pas à la Suisse), etc. Le Royaume-Uni pourrait avoir à choisir entre se plier à des normes européennes sur lesquelles il n’aura pas son mot à dire ou se voir imposer des barrières réglementaires. Certes, la négociation sera ouverte. Le Royaume-Uni pourra plaider pour une Europe plus ouverte aux pays hors-UE. Mais quel sera son poids une fois sorti ?
L’attitude dure, visant à punir Londres pour faire un exemple et décourager les futurs candidats à la sortie, consisterait au contraire à imposer au Royaume-Uni de renégocier l’ensemble des traités commerciaux en partant de zéro (donc des seules règles de l’OMC) à inciter les entreprises multinationales à relocaliser en Europe continentale leurs usines et sièges sociaux, à fermer l’accès du marché européen aux banques britanniques de façon à les inciter à rapatrier à Paris ou à Francfort l’activité bancaire et financière de la zone euro. Mais, il paraît difficile que l’Europe, partisan de la libre-circulation des marchandises, des services, des personnes, des entreprises, se mette à dresser des obstacles contre le Royaume-Uni. La zone euro a un excédent courant de 130 milliards d’euros avec le Royaume-Uni : voudra-t-elle le remettre en cause ? Les entreprises européennes qui exportent au Royaume-Uni s’y opposeraient. Les accords de coopération industrielle (Airbus, Armement, Energie, ..) pourraient difficilement être remis en question. Il paraît a priori peu probable que Londres dresse des barrières tarifaires contre les produits européens, sauf en représailles. En sens inverse, Londres pourrait jouer la carte du paradis fiscal et réglementaire, en particulier en matière financière. Mais, il ne pourrait guère s’abstraire de contraintes internationales (les accords de la COP21, ceux sur la lutte contre l’optimisation fiscale, ceux sur l’échange international d’informations fiscales et bancaires). Le risque est de rentrer dans un coûteux jeu de représailles réciproques (que l’Europe, divisée entre des pays à intérêts différents, aura du mal à mener).
En cas de sortie de l’UE, le Royaume-Uni, contributeur net à l’UE, économiserait a priori environ 9 milliards d’euros par an, soit 0,35% de son PIB. Toutefois, les pays de l’AELE et la Suisse contribuent au budget européen dans le cadre du marché unique. Là encore, tout dépendra de la négociation. On peut penser que le gain pour le Royaume-Uni ne sera que de l’ordre de 4,5 milliards d’euros, que les autres pays membres devront prendre en charge (soit un coût de l’ordre de 0,5 milliard d’euros pour la France).
Compte tenu des incertitudes sur la négociation (et sur l’évolution du taux de change), toutes les évaluations sur l’impact du Brexit sur les autres pays de l’UE ne peuvent être que très problématiques. Par ailleurs, l’effet pour les pays de l’UE est forcément de second ordre : si des barrières tarifaires ou non tarifaires réduisent les exportations de voitures françaises vers le Royaume-Uni et des voitures britanniques vers la France, les producteurs français pourront fournir leur marché national avec moins de concurrence et pourront aussi se tourner vers les pays tiers. Un ordre de grandeur est cependant utile : les exportations de la France (de l’UE) vers le Royaume-Uni représentaient en 2015 1,45% de son PIB (2,2%) ; les exportations du Royaume-Uni vers l’UE représentaient 7,1% de son PIB. A priori, un choc équivalent sur le commerce RU/UE a 3,2 fois moins d’impact sur l’UE que le Royaume-Uni.
Ainsi, selon l’OCDE[2], la baisse du PIB de l’UE serait à terme, en 2023, de 0,8% (contre 2,5% pour le Royaume-Uni), tandis que rester dans l’UE, participer à l’approfondissement du marché unique et signer des accords de libre-échange avec le reste du monde permettrait une hausse du PIB pour tous les pays de l’UE. Mais quelle est la crédibilité de cette dernière affirmation, compte tenu des mauvaises performances actuelles de la zone euro et du coût de l’ouverture des frontières pour la cohésion économique et sociale des pays européens ? Beaucoup des canaux évoqués par l’OCDE sont contestables : le Brexit affaiblirait la croissance en augmentant l’incertitude économique et en affaiblissant les perspectives économiques. Mais si l’Europe fonctionne mal, la quitter devrait améliorer les perspectives des marchés. Le Royaume-Uni subirait une contraction de son commerce extérieur, qui nuirait durablement à sa productivité, mais, malgré l’ouverture de son économie, la productivité de l’économie britannique est déjà faible. L’OCDE ne pose pas la question de principe : un pays doit-il abandonner sa souveraineté politique pour bénéficier des éventuels effets positifs de la libéralisation commerciale ?
Selon la fondation Bertelsmann[3], la baisse du PIB de l’UE (hors RU) en 2030 irait de 0,10% dans le cas d’une sortie douce (le Royaume-Uni ayant un statut similaire à celui de la Norvège) à 0,36% dans le cas défavorable (le Royaume-Uni devant renégocier tous ses traités commerciaux), la France étant peu touchée (-0,06 % et -0,27%), l’Irlande, la Belgique et le Luxembourg beaucoup plus. Puis l’étude multiplie ces chiffres par cinq pour intégrer des effets dynamiques de moyen terme, la baisse du commerce extérieur étant censée avoir des effets défavorables sur la productivité.
Euler-Hermès aboutit aussi à des chiffres très faibles pour les pays de l’UE : une baisse de 0,4% du PIB avec un accord de libre-échange ; de 0,6 % sans accord. L’impact est plus important pour les Pays-Bas, l’Irlande et la Belgique.
Un rebond de l’Europe, avec ou sans le Royaume-Uni…
L’Europe devra tirer les leçons de la crise britannique, qui vient après la crise des dettes des pays du Sud, la crise grecque, les politiques d’austérité, en même temps que celle des migrants. Ce ne sera pas une tâche aisée. Il faudra à la fois repenser le contenu des politiques et leur cadre institutionnel. L’UE en aura-t-elle la capacité ?
Les déséquilibres entre pays membres se sont accrus de 1999 à 2007. Depuis 2010, la zone euro n’a pas été capable de mettre en place une stratégie coordonnée permettant le retour vers un niveau satisfaisant d’emploi et la résorption des déséquilibres entre Etats membres. Les performances économiques sont médiocres pour de nombreux pays de la zone euro et catastrophiques pour les pays du Sud. La stratégie mise en œuvre dans la zone euro depuis 1999, renforcée depuis 2010 : « discipline budgétaire/réformes structurelles » n’a guère donné des résultats satisfaisants sur les plans économiques et sociaux. Par contre, elle donne aux peuples l’impression d’être dépossédés de tout pouvoir démocratique. C’est encore plus vrai pour les pays qui ont bénéficié de l’assistance de la troïka (Grèce, Portugal, Irlande) ou de la BCE (Italie, Espagne). Depuis 2015, le plan Juncker destiné à relancer l’investissement en Europe a marqué un certain tournant, mais celui-ci demeure timide et mal assumé : il ne s’accompagne pas d’une réflexion sur la stratégie macroéconomique et structurelle. Les désaccords sont importants en Europe tant entre les nations qu’entre les forces politiques et sociales. Dans la situation actuelle, l’Europe a besoin d’une stratégie économique forte, mais celle-ci ne peut pas être aujourd’hui décidée collectivement en Europe.
Ce marasme a selon nous deux causes fondamentales. La première concerne l’ensemble des pays développés. Il apparaît de plus en plus que la mondialisation creuse un fossé profond entre ceux qui y gagnent et ceux qui y perdent[4]. Les inégalités de revenus et de statuts se creusent. Les emplois stables, correctement rémunérés disparaissent. Les classes populaires sont les victimes directes de la concurrence des pays à bas salaires (que ce soient les pays asiatiques ou les anciennes démocraties populaires). On leur demande d’accepter des baisses de salaires, de prestations sociales, de droits du travail. Dans cette situation, les élites et les classes dirigeantes peuvent être ouvertes, mondialistes et pro-européennes tandis que le peuple est protectionniste et nationaliste. C’est le même phénomène qui explique la poussée du Front National de l’AfD, de l’UKIP, et aussi aux Etats-Unis de Donald Trump chez les Républicains.
L’Europe est actuellement gérée par un fédéralisme libéral et technocratique, qui veut imposer aux peuples des politiques ou des réformes, que ceux-ci refusent, pour des raisons parfois légitimes, parfois discutables, parfois contradictoires. Le fait est que l’Europe, telle qu’elle est actuellement, affaiblit les solidarités et cohésions nationales, ne permet pas aux pays de choisir une stratégie spécifique. Le retour à la souveraineté nationale est une tentation générale.
Par ailleurs l’Europe n’est pas un pays. Il existe entre les peuples des divergences importantes d’intérêt, de situations, d’institutions, d’idéologies qui rendent tout progrès difficile. En raison de la disparité des situations nationales, de nombreux dispositifs (que ce soit la politique monétaire unique, la liberté de circulation des capitaux et des personnes), posent problème. Des règles sans fondement économique ont été introduites dans le Pacte de Stabilité ou le Traité Budgétaire : elles n’ont pas été remises en cause après la crise financière. Dans nombre de pays, les classes dirigeantes, les responsables politiques, les hauts-fonctionnaires ont choisi de minimiser ces problèmes, pour ne pas contrarier la construction européenne. Des questions cruciales d’harmonisation fiscale, sociale, salariale, réglementaire ont été volontairement oubliées. Comment faire converger vers une Europe sociale ou une Europe fiscale des pays dont les peuples sont attachés à des systèmes structurellement différents ? Après les difficultés de l’Europe monétaire, qui peut souhaiter une Europe budgétaire, qui éloignera encore l’Europe de la démocratie ?
Dans l’accord du 19 février, le Royaume-Uni a fait rappeler les principes de subsidiarité. Il est compréhensible que des pays, soucieux de souveraineté nationale, soient agacés (pour ne pas dire plus) par les intrusions incessantes de l’UE dans des domaines qui relèvent de la compétence nationale, où les interventions européennes n’apportent guère de valeur ajoutée. Il est compréhensible que ces pays refusent de devoir en permanence se justifier à Bruxelles sur leurs politiques économiques ou sur leurs règles économiques, sociales ou juridiques même quand celles-ci n’ont aucune conséquence sur les autres Etats membres. Le Royaume-Uni a fait noter que les questions de justice, de sécurité, de libertés restaient de compétence nationale. L’Europe devra tenir compte de ce sentiment d’exaspération. Après le départ britannique, il faudra arbitrer entre deux stratégies : renforcer l’Europe au risque d’accroître encore le sentiment de dépossession des peuples ou réduire l’ambition de la construction européenne.
Le départ du Royaume-Uni, l’éloignement de fait de certains pays d’Europe centrale (Pologne, Hongrie), les réticences du Danemark et de la Suède pourraient pousser à passer explicitement à une Union à deux vitesses. Beaucoup d’intellectuels et de personnalités politiques, nationaux ou européens, pensent que la présente crise pourrait en être l’occasion. L’Europe serait explicitement partagée en trois cercles. Le premier regrouperait les pays de la zone euro qui, tous, accepteraient de nouveaux transferts de souveraineté et bâtiraient une union budgétaire, fiscale, sociale et politique poussée. Un deuxième regrouperait les pays européens qui ne souhaiteraient pas participer à cette union. Enfin, le dernier cercle regrouperait les pays liés à l’Europe par un accord de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse aujourd’hui, d’autres pays et le Royaume-Uni demain)
Ce projet pose cependant de nombreux problèmes. Les institutions européennes devraient être dédoublées entre des institutions zone euro fonctionnant sur le mode fédéral (qu’il faudrait rendre plus démocratique) et des institutions de l’UE continuant à fonctionner sur le mode Union des Etats membres. Beaucoup de pays actuellement en dehors de la zone euro sont hostiles à cette évolution qui, selon eux, les marginaliserait en membre de ‘seconde zone’. Elle compliquerait encore le fonctionnement de l’Europe s’il y a un Parlement européen et un Parlement de la zone euro, des commissaires zone euro, des transferts financiers zone euro et des transferts UE, etc. C’est déjà le cas, par exemple, avec l’Agence bancaire européenne et la BCE. De nombreuses questions devraient être tranchées deux ou trois fois (une fois au niveau de la zone euro, une fois au niveau de l’UE, une fois au niveau de la zone de libre-échange).
Selon la question, le pays membre pourrait choisir son cercle, on irait vite vers une union à la carte. Cela est difficilement compatible avec une démocratisation de l’Europe puisqu’il faudrait vite un Parlement par question.
Les membres du troisième cercle seraient eux dans une situation encore plus difficile, obligés de se plier à des réglementations sur lesquels ils n’auront aucun pouvoir. Faut-il placer nos pays partenaires devant le dilemme : accepter de lourdes pertes de souveraineté (en matière politique et sociale) ou se voir priver des avantages du libre-échange ?
Il n’y a sans doute pas d’accord des peuples européens, même au sein de la zone euro, pour aller vers une Europe fédérale, avec toutes les convergences que cela supposerait. Dans la période récente, les cinq présidents et la Commission ont proposé de nouveaux pas vers le fédéralisme européen : création d’un Comité budgétaire européen, création de Conseils indépendants de compétitivité, conditionnement de l’octroi des fonds structurels au respect de la discipline budgétaire et à la réalisation des réformes structurelles, création d’un Trésor européen et d’un ministre des finances de la zone euro, évolution vers une Union financière, unification partielle des systèmes d’assurance chômage. Cette évolution renforcerait le pouvoir d’organismes technocratiques au détriment des gouvernements démocratiquement élus. Il serait déplaisant qu’elle soit mise en œuvre, comme c’est déjà le cas en partie, sans que les peuples soient consultés.
Par ailleurs, nul ne sait comment se ferait la convergence en matières fiscale ou sociale. Vers le haut ou vers le bas ? Certains proposent une union politique où les décisions seraient prises démocratiquement par un gouvernement et un parlement de la zone euro. Mais peut-on imaginer un pouvoir fédéral, même démocratique, capable de prendre en compte les spécificités nationales dans une Europe composée de pays hétérogènes ? Peut-on imaginer les décisions concernant le système de retraite français prises par un Parlement européen ? Ou un ministre des finances de la zone imposant des baisses de dépenses sociales aux pays membres (comme la troïka le fait pour la Grèce) ? ou des normes automatiques de déficit public ? Selon nous, compte tenu de la disparité actuelle en Europe, les politiques économiques doivent être coordonnées entre pays et non décidées par une autorité centrale.
L’Europe devra engager une réflexion sur son avenir. Utiliser la crise actuelle pour progresser sans réflexion vers « une union toujours plus étroite » serait dangereux. L’Europe doit vivre avec une contradiction : les souverainetés nationales auxquelles les peuples sont attachés doivent être respectées tant que faire se peut ; l’Europe doit mettre en œuvre une stratégie macroéconomique et sociale, forte et cohérente. L’Europe n’a pas de sens en elle-même, elle n’en a que si elle met en œuvre en projet, défendre un modèle spécifique de société, la faire évoluer pour intégrer la transition écologique, éradiquer le chômage de masse, résoudre les déséquilibres européens de façon concertée et solidaire. Mais il n’y a pas d’accord en Europe sur la stratégie à mener pour atteindre ces objectifs. L’Europe, incapable de sortir globalement les pays membres de la récession, de mettre en œuvre une stratégie cohérente face à la mondialisation, est devenue impopulaire. Ce n’est qu’après un changement réussi de politiques qu’elle pourra retrouver l’appui des peuples et que des progrès institutionnels pourraient être mis en œuvre.
[1] Voir, en particulier le rapport du Sénat ; Albéric de Montgolfier : Les conséquences économiques et budgétaires d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, juin 2016.
[2] OCDE, 2016, The Economic Consequences of Brexit: A Taxing Decision, avril. Notons qu’assimiler la sortie de l’Euro à une hausse des impôts est n’a pas de sens économique et est une communication peu digne de l’OCDE.
[3] Brexit –potential economic consequences if the EU exit the EU,, Policy Brief, 2015/05.
[4] Voir par exemple, Joseph E. Stiglitz, 2014, « Le prix de l’inégalité », Les Liens qui libèrent, Paris.