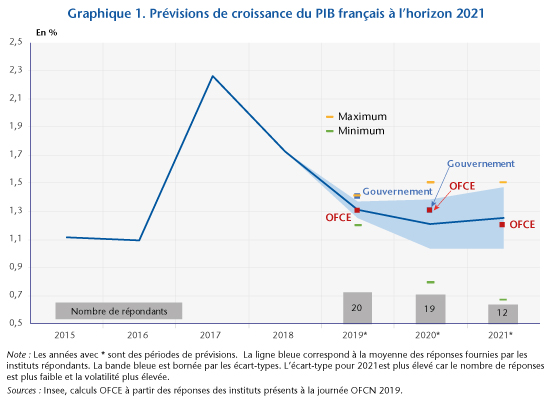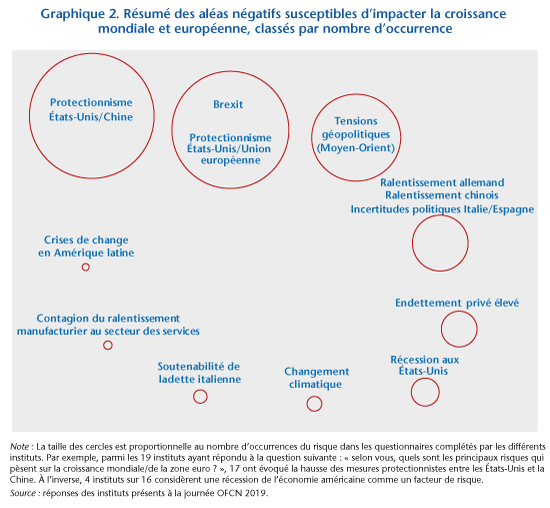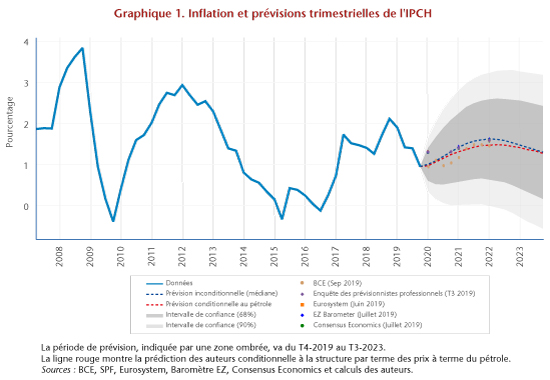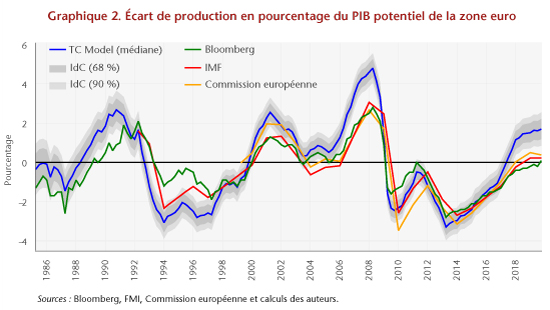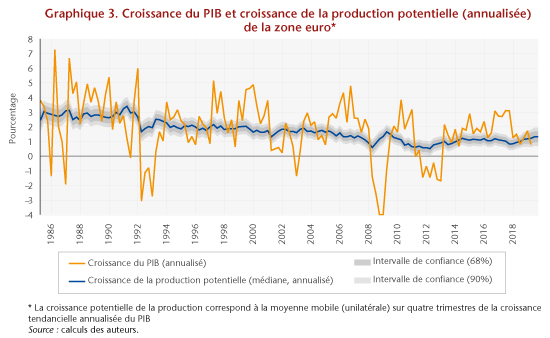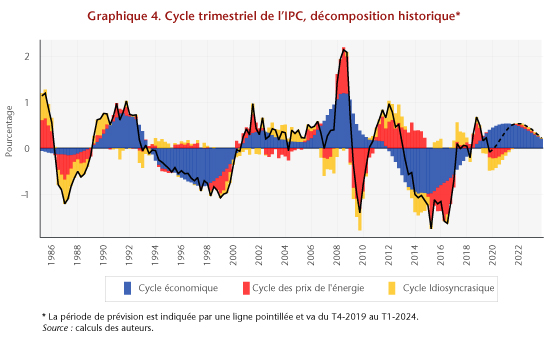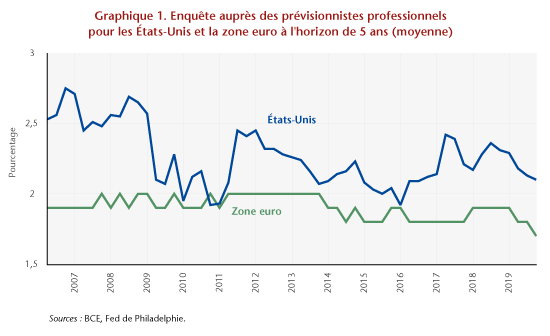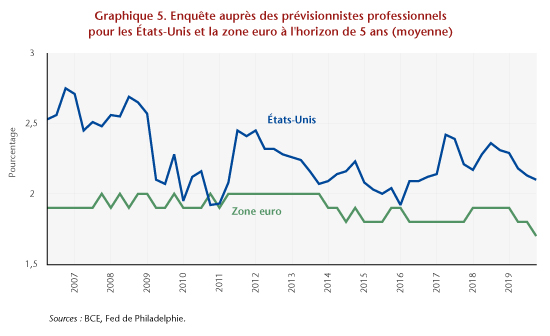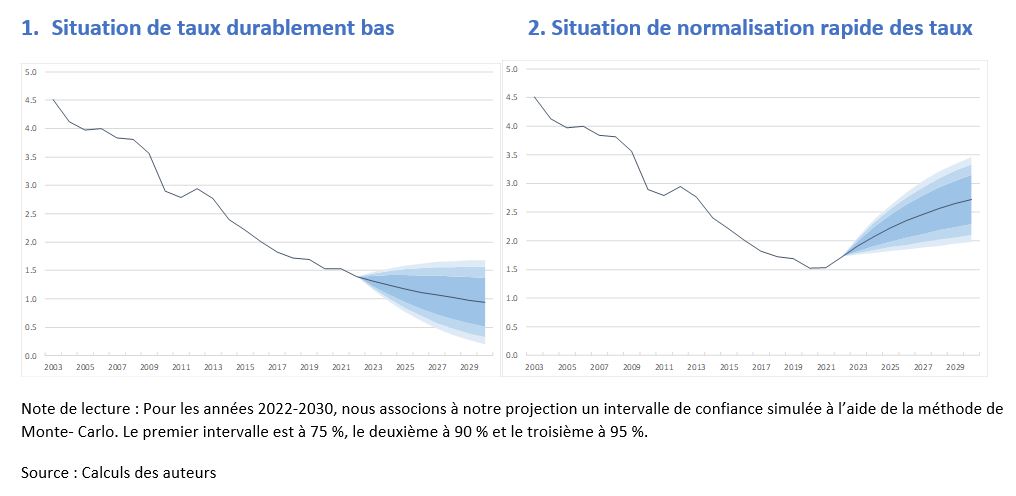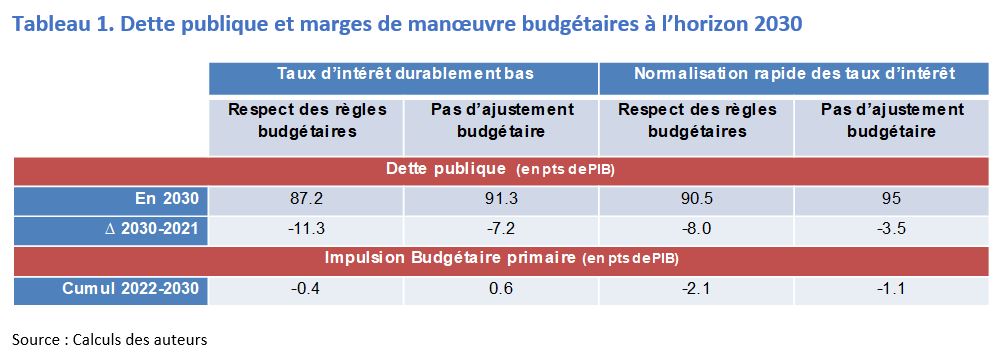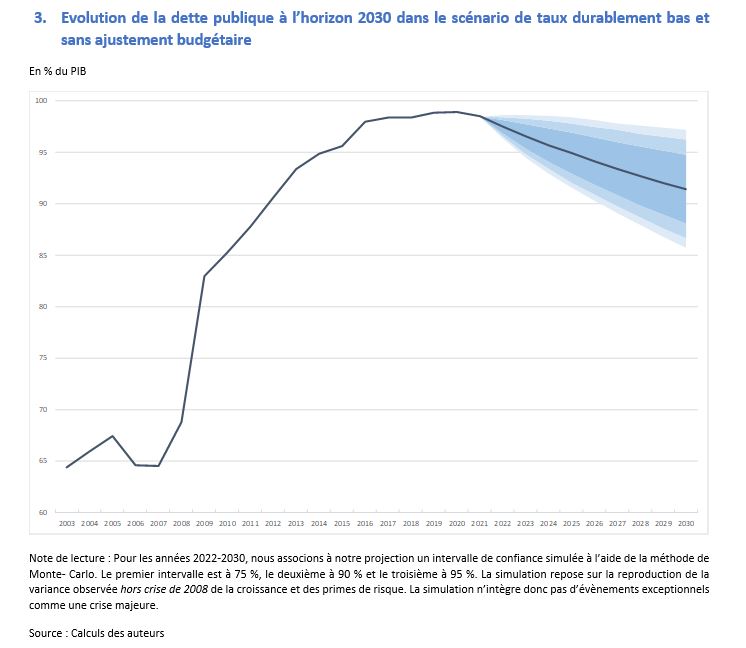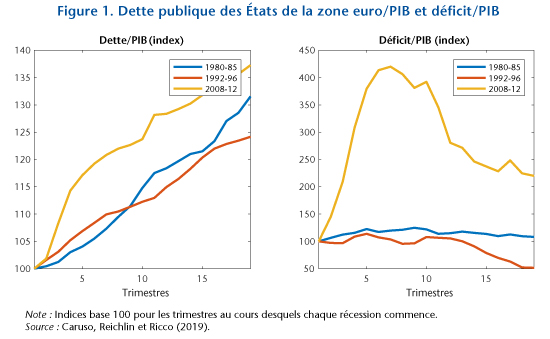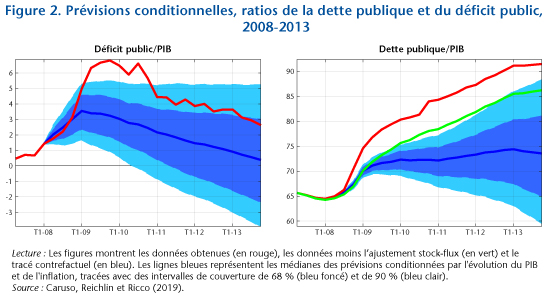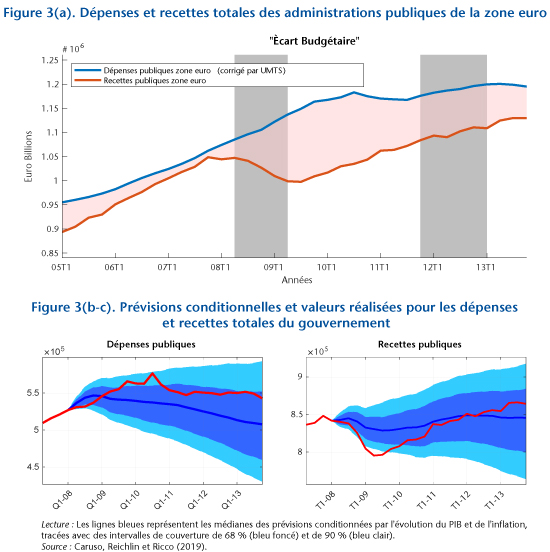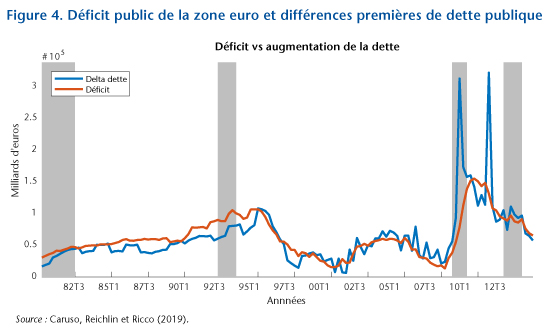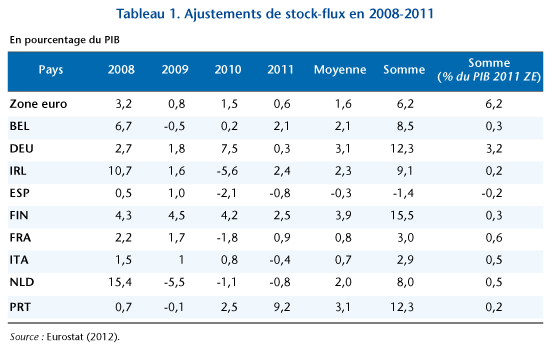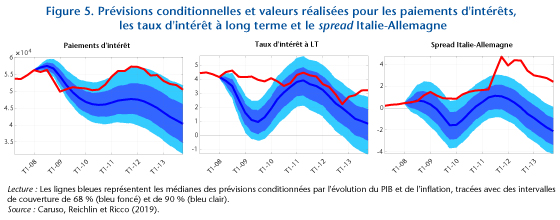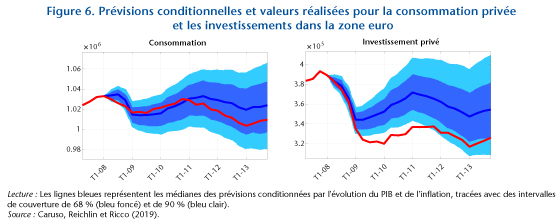par Catherine Mathieu et Henri Sterdyniak
« Une plus grande cohésion dans un monde de plus en plus
fracturé : où en est le projet européen ? ». Tel était le thème
du 16e Colloque EUROFRAME
sur les questions de politique économique dans l’Union européenne, qui s’est
tenu le 7 juin 2019 à Dublin[1].
Cette note fournit un résumé des travaux présentés et discutés lors du colloque.
Comme le souligne le titre du colloque, l’année 2019 est marquée
par les risques de fractures de l’économie mondiale. Donald Trump a lancé une
guerre commerciale contre la Chine et l’Europe. Il met en cause l’accord de
Paris sur la lutte contre le changement climatique. L’Union européenne (UE) est
sous la menace du Brexit alors que les questions migratoires comme les
questions de fonctionnement démocratique opposent les pays de l’Ouest à ceux de
l’Est de l’Europe. Les accords commerciaux bilatéraux peuvent être considérés
comme un progrès ; en même temps, ils mettent en cause l’utilité de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). Les négociations sur la fiscalité des entreprises
multinationales ont été engagées, mais piétinent du fait des intérêts
nationaux. Dans ce contexte, la zone euro a fait des progrès institutionnels,
mais ceux-ci, difficiles à mettre en place, sont restés limités. L’Europe a un
rôle crucial à jouer pour mettre en place les instruments indispensables de
gestion de la mondialisation, en matière écologique, commerciale, fiscale,
financière mais cela demanderait une unité et une impulsion politique qui font
défaut aujourd’hui. Comment relancer le projet européen ?
La présentation introductive de Karl Wheelan portait sur les
problèmes spécifiques de l’euro. La monnaie unique apparaît comme un succès
puisqu’elle a survécu, qu’elle bénéficie du soutien des peuples, qu’elle a
assuré la stabilité des prix, mis fin à l’instabilité des taux de change entre
pays membres, que l’union bancaire est en voie d’être achevée. La politique
monétaire a pu être réactive. Mais les déséquilibres se sont creusés entre
États membres, le risque de défaut sur les dettes publiques est apparu, les
risques de faillite bancaire se sont accrus. Des progrès restent à faire :
repenser les règles de politique budgétaire, créer une capacité d’intervention
budgétaire à l’échelle de la zone, prévoir un mécanisme de restructuration des
dettes publiques, inciter les banques à détenir moins de dette publique de leur
pays en la considérant comme risquée, créer un mécanisme européen d’assurance
des dépôts, préciser la fonction de prêteur en dernier ressort de la BCE
vis-à-vis des banques et des États. L’exemple du Brexit montre que la construction
européenne reste à la merci des mouvements nationalistes.
Marek Dabrowski dresse un panorama de l’histoire de l’euro depuis
20 ans. L’auteur se félicite du succès de la monnaie unique, mais s’inquiète
toutefois des réticences de certains pays à achever les réformes nécessaires.
Il propose d’approfondir l’intégration politique, d’augmenter la taille du
budget européen pour financer des projets communs, de renforcer la discipline
de marché pour contrôler les politiques budgétaires, de simplifier et de
renforcer l’application des règles budgétaires. Il estime que les pays d’Europe
centrale et orientale membres de l’UE mais qui n’ont pas adopté l’euro
devraient se donner l’objectif de le faire dans un futur proche, ce qui
permettrait de simplifier l’architecture institutionnelle de l’UE.
Dans la discussion, plusieurs points de vue ont été exprimés. Selon
Klaus-Jürgen Gern, l’UE doit choisir entre deux paradigmes. L’Union budgétaire,
avec plus d’harmonisation, de coordination et de partage des risques,
nécessiterait, selon l’auteur, la restriction budgétaire dans beaucoup de pays,
la stricte application de règles budgétaires, des réformes structurelles des
marchés des biens et du travail, qui devraient être prises en charge au niveau
de chaque pays. Maastricht 2.0 reposerait sur la diversité, la concurrence et
la responsabilité de chaque pays. La clause de non-assistance devrait être
renforcée ; elle serait rendue crédible en renforçant l’Union bancaire par
un filet de protection européen, en brisant le lien entre les banques et la
dette de leur pays d’origine ; en créant un mécanisme de restructuration
des dette publiques.
Pour notre part, nous nous sommes inquiétés de projets qui
fragiliseraient les politiques économiques des États membres, décidées
démocratiquement, au profit d‘institutions européennes technocratiques,
éloignées des réalités nationales. Nous avons rappelé l’exemple des politiques
budgétaires inappropriées imposées après la crise financière. Il nous semble
dangereux d’affaiblir la capacité des États à se financer et de compter sur les
marchés financiers pour imposer la bonne politique budgétaire. Certains ont
estimé que tout projet doit tenir compte des disparités et des divergences
politiques et économiques entre les pays de l’UE.
Le Brexit
Mathieu et Sterdyniak présentent un survol des questions posées par le Brexit. Ils analysent les positions des institutions européennes et celles des forces politiques au Royaume-Uni, entre les partisans de rester dans l’UE, les partisans d’un partenariat étroit et les partisans d’une franche rupture, éventuellement sans accord, positions qui ont conduit à une impasse. Jusqu’à présent, les résultats du referendum n’ont pas entrainé la récession annoncée, mais un léger ralentissement de la croissance. L’article présente les différents travaux macroéconomiques qui évaluent l’impact à long terme du Brexit sur l’économie britannique. L’impact serait très négatif si le Brexit se traduit par une fermeture du Royaume-Uni qui aurait des effets durables sur la croissance de la productivité du travail.
Compte-tenu de l’actualité et du lieu de la conférence, trois interventions ont porté sur l’impact du Brexit sur l’Irlande. Martina Lawless analyse en détail les secteurs économiques et les comtés qui seraient frappés par le Brexit, en particulier par un Brexit sans accord. Le commerce entre les deux parties de l’île est intense et de type local, plutôt qu’international. Ce sont les petites entreprises et le secteur agricole (produits laitiers, viande) qui courent le plus grand risque. La baisse du commerce ne pourrait être compensée par une hausse des investissements directs étrangers (IDE). Globalement, le choc pourrait être une baisse du PIB de 4 à 6% pour la République d’Irlande.
L’étude d’Arriola et al. souligne que la République d’Irlande est le pays de l’UE qui a le plus de liens économiques avec le Royaume-Uni ; en particulier, le secteur agricole exporte beaucoup vers le Royaume-Uni ; beaucoup de biens intermédiaires utilisés par les entreprises irlandaises proviennent du Royaume-Uni, de sorte que les chaines de production devront être restructurées ; l’effet de relocalisation des IDE serait positif, mais faible. Au total, l’effet à long terme ne serait qu’une baisse du PIB de 2,3%.
Adele
Bergin et al. comparent 3 scénarios :
la sortie avec accord, la sortie ordonnée sans accord et la sortie désordonnée
sans accord. Dans les 3 cas, l’effet négatif sur le commerce est un peu
compensé par un effet positif via les IDE. Au total, l’effet à 10 ans sur le
PIB de la République d’Irlande serait de -2,6 ; -4,8 ou -5%, selon le scénario.
Questions
monétaires
Rachel Slaymaker et al.analysent les arriérés de paiements sur
les crédits au logement en Irlande. Ils montrent que ceux-ci dépendent du
revenu du ménage, du montant de leur dette, mais qu’ils sont plus importants
pour les crédits à taux variable et à la suite d’une hausse des taux d’intérêt,
ce qui posera problème quand la période de bas taux d’intérêt prendra fin.
Roberto Pancrazi et Luca Zavalloni montrentqu’un pays en difficulté peut se trouver en face de taux d’intérêt
trop élevés qui l’incitent à faire faillite au détriment de ses créanciers.
Cela peut justifier une intervention publique (ou une aide internationale) pour
réduire le coût de son nouvel endettement. L’article montre que cette politique
peut être Pareto-améliorante, ce qui justifie l’intervention du Fonds monétaire
international (FMI), du mécanisme européen de stabilité (MES), ou l’émission de
titres seniors.
Jérôme Creel et Mehdi El Herradi analysent avec un modèle VAR le
lien entre la politique monétaire et les inégalités de revenu. Ils estiment
qu’une politique monétaire restrictive tend à augmenter les inégalités de
revenu, l’effet étant surtout sensible pour les pays périphériques (Espagne,
Grèce, Italie, Portugal).
Économie bancaire
Ray
Barrell et Dilruba Karim analysent les déterminants des crises financières. Deux
variables jouent un rôle central : le déficit du solde courant et la
croissance des prix de l’immobilier ; deux variables jouent un rôle
stabilisateur : le capital des banques et leur liquidité. Par contre, le
rôle de la croissance du crédit bancaire n’est pas mis en évidence. Par
ailleurs, certaines crises demeurent inexpliquées. Les auteurs estiment que des
exigences en termes de ratio de capital sont le meilleur outil de politique
macroprudentielle, ainsi que le contrôle de la qualité du crédit, plutôt que de
sa quantité.
Hiona Balfoussia, Dellas et Papageorgiou analysent la relation entre le risque de défaut de l’Etat et le risque
de défaut des banques. La fragilité des finances publiques renforce, par le
canal du crédit, l’impact des chocs économiques. Cette fragilité peut être
évitée si les exigences de fonds propres des banques sont ajustées de façon
optimale. Appliquée à l’Union bancaire, l’analyse montre que les pays fragiles
peuvent avoir intérêt à l’union, tandis que les pays avec des finances
publiques en bonne santé peuvent en pâtir.
José
Carrasco-Gallego utilise un modèle DSGE pour comparer les propriétés
stabilisatrices de deux instruments de la politique macroprudentielle, le ratio
prêts/valeur (LTV) ou le ratio contracyclique de fonds propres (CCB). Il montre
que chacun de ces ratios peut amener, pour certains types de chocs à des
réactions inappropriées et que leurs indications peuvent être contradictoires.
Elizabeth Jane Casabianca et
al. comparent deux méthodes pour prévoir les crises bancaires, soit un
modèle logit économétrique, soit un algorithme d’apprentissage machine. Il
apparait que les variables pertinentes sont le poids de la dette extérieure, le
ratio crédit/PIB, l’inflation, le taux américain à 10 ans. Une forte croissance
mondiale augmente le risque de crise bancaire. Le ratio dette publique/PIB n’a
pas de valeur prédictive. Pour les pays développés, l’algorithme prévoit 53
crises sur 128 et donne 40 fausses alertes sur 785 situations. En 2006, le
risque de crise dépassait 50 % pour 25 pays ; en 2017, il atteint 40 %
pour 9 pays (dont le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas et la Suisse).
Finance
Amat Adarov met en évidence des cycles financiers dans 20 pays européens de
1960 à 2015. Ces cycles se caractérisent par des périodes d’expansion où des déséquilibres
se constituent, suivis de contractions brutales. Ces cycles sont
particulièrement importants et synchronisés pour les pays du cœur de la zone
euro. Ils doivent être pris en compte pour analyser les cycles économiques et
la dynamique de la dette publique, mais aussi dans l’organisation de l’Union
bancaire, de l’Union des marchés de capitaux et dans les objectifs de la politique monétaire.
Robert Unger revient sur le lien entre croissance et
développement. Selon une analyse empirique basée sur 34 pays développés de 1995
à 2014, c’est l’endettement des ménages, plutôt que celui des entreprises, qui
joue un rôle crucial, favorisant d’abord la croissance, puis lui étant nuisible
au-delà d’un certain seuil. L’étude ne met pas en évidence de différence entre
le financement par crédit bancaire ou par les marchés financiers.
Politique
budgétaire
Beau Soederhuizen et al.
utilisent un modèle VAR pour évaluer le multiplicateur budgétaire selon l’état
du cycle financier. Le multiplicateur des dépenses d’investissement serait
négatif en période de hausse des tensions financières et positif, supérieur à
1, en période de décrue. En prenant en compte le cycle conjoncturel, il
apparait que ces effets sont amplifiés en période de récession et affaiblis en
période d’expansion. Le multiplicateur des dépenses de consommation serait plus
faible et dépendrait moins du cycle financier.
Pedro Gomes et Felix Wellschmied analysent le fonctionnement du
marché du travail des secteurs publics et privés aux États-Unis, Royaume-Uni,
France et Espagne. Les travailleurs font des choix différents d’emploi entre
les deux secteurs au cours du cycle de vie selon leur aversion pour le risque,
selon leur patrimoine et selon l’importance qu’ils attribuent à la sécurité de
l’emploi et au différentiel de pensions de retraite.
Harris Dellas et al. construisent
un modèle d’équilibre général calculable de l’économie grecque, qui incorpore
un secteur informel dont la taille varie selon les taux d’imposition et le
contrôle des flux financiers. Ils montrent que les politiques de restrictions
budgétaires se sont traduites par une augmentation de 50% du secteur informel,
de sorte que le PIB officiel a baissé de 26% (au lieu des 18% initialement envisagés),
mais qu’en fait la production n’a baissé que de 17%.
Salvador Barrios et al. proposent
d’analyser les mesures de politique fiscale en utilisant une base de données
sur les réformes de l’impôt sur le revenu. Celles-ci sont décrites finement dans
un modèle de microsimulation ; leur impact macroéconomique est évalué à
l’aide d’un modèle VAR dont les résultats sont incorporés dans un modèle
macroéconomique. Il apparait que les réductions de l’impôt sur le revenu ont
bien un effet positif sur la production et l’emploi, mais les hausses de
recettes publiques sont insuffisantes pour inverser l’impact négatif de la
baisse de l’impôt sur le solde public.
Sebastian Weiske et Mustafa Yeter comparent différents mécanismes
de transferts budgétaires entre Etats membres. Ceux-ci devraient permettre de
stabiliser les économies des pays membres, sans induire des transferts
permanents, sans induire d’accumulation de dette, sans encourager des
comportements d’hasard moral. Il faut réaliser un arbitrage délicat entre
stabilisation et accumulation de dettes. Les auteurs proposent d’instaurer un
plafond sur les transferts nets reçus (ou versés) par chaque pays.
Commerce et
solde extérieur
Kieran McQuinn et Petros Varthalitis
montrent que la croissance de l’économie irlandaise, d’abord portée par le
secteur exportateur, a été impulsée de 2004 à 2007 par une bulle immobilière. La
crise financière a permis de rééquilibrer l’économie en faveur du secteur
industriel. La reprise de l’économie irlandaise ne s’explique pas par des
réformes structurelles, mais par le développement des exportations.
Cian Allen analyse empiriquement, de 1995 à 2015, pour les pays du
G20, l’impact sur les fluctuations du solde courant des fluctuations du solde
public, du solde des ménages, des entreprises et du secteur financier. Il
montre que ce sont les fluctuations du solde public et du solde des entreprises
(plutôt que celles du solde des ménages) qui jouent un rôle crucial.
Pascal Jacquinot et al. analysent,
dans un modèle dynamique d’équilibre général, avec des frictions sur le marché
de travail, l’impact de mesures protectionnistes. Celles-ci nuisent à l’emploi
dans le pays qui les entreprend, comme dans le pays qui en est victime ;
les pays tiers peuvent bénéficier d’un léger effet positif. Par contre, des
mesures frappant un des pays de la zone euro ont des effets récessifs sur
l’ensemble de la zone.
John
Lewis et Matt Swannell utilisent un modèle de gravité pour analyser les flux
migratoires. Ils mettent en évidence l’impact des variables de distance, de
liens historiques, de langue commune, du nombre de migrants déjà installés,
mais aussi de variables macroéconomiques, comme la croissance anticipée tant
dans le pays d’origine (avec un impact négatif) que dans le pays destination
(avec un impact positif) et la flexibilité du marché du travail.
Tatiana
Cesaroni et al. expliquent l’évolution
des inégalités dans les pays européens en séparant les pays du cœur et ceux de
la périphérie. La hausse du chômage contribue à la hausse des inégalités dans
les deux zones. La croissance du PIB par tête réduit les inégalités dans les
pays du cœur, l’augmente dans les pays de la périphérie. L’intégration
commerciale et financière, la fiscalité réduisent les inégalités dans les pays
périphériques. Elles ont peu d’impact dans les pays du cœur. Les auteurs en
concluent que les politiques redistributives doivent être pensées au niveau
national.
Angelos
Angelopoulos et al. analysent
l’impact de la recherche de rentes sur l’activité économique et la croissance.
La recherche de rentes peut être un stimulant pour accumuler de la richesse et
pour se protéger des chocs de revenu ; cependant, elle détourne de
l’activité productive, elle immobilise des capitaux et finalement elle induit
une hausse des inégalités de revenu.
Tryfon Christou et al.
estiment que dans des pays où les institutions sont de mauvaise qualité, les
individus consacrent une partie de leur temps de travail à s’emparer de rentes.
En distinguant les pays selon la qualité de leurs institutions, ils concluent
que les pays qui ont des institutions de meilleure qualité ont moins souffert
de la crise et que celle-ci a entrainé une détérioration de la qualité de leurs
institutions.
Interventions :
Karl Wheelan (University College
Dublin) : The Euro at 20: Successes,
Problems, Progress and Threats.
Marek Dabrowski (CASE, Varsovie):
The Economic and Monetary Union: Past, present and future
Catherine Mathieu et Henri Sterdyniak (OFCE) : Brexit: Why, how, and when?
Martina Lawless (ESRI) : Brexit and trade on the island of Ireland.
Christine Arriola, Caitlyn Carrico, David
Haugh, Nigel Pain, Elena Rusticelli, Donal Smith, Frank van Tongeren et
Ben Westmore (OCDE) : The potential macroeconomic and sectoral consequences of Brexit on
Ireland.
Adele Bergin (ESRI), Philip Economides
(ESRI), Abian Garcia-Rodriguez (ESRI et Trinity College) et Gavin Murphy
(Department of Finance, Ireland) : Ireland
and Brexit: Modelling the impact of deal and no-deal scenarios.
Rachel Slaymaker, Conor O’Toole, Kieran
McQuinn (ESRI) et Mike Fahy, (Trinity College Dublin): Policy normalisation and mortgage arrears in a recovering economy: The
case of the Irish residential market.
Roberto Pancrazi (Université de Warwick)
et Luca Zavalloni (Banque centrale d’Irlande) : Interest overhang: a rationale
for the existence of sovereign lending mechanisms.
Jérôme Creel (OFCE et ESCP Europe) et
Mehdi El Herradi (Université de Bordeaux-LAREFI) : Shocking aspects of monetary policy on income
inequality in the Euro Area.
Ray Barrell et Dilruba Karim (LSE et
Brunel University, Londres) : Bank
capital, excess credit and crisis incidence.
Hiona Balfoussia (Banque de Grèce), Harris
Dellas (Université de Berne et CEPR) et Dimitris
Papageorgiou (Banque de Grèce) : Fiscal distress and banking performance: The role of
macroprudential regulation.
José A. Carrasco-Gallego (King Juan Carlos
University, Madrid) : Effectiveness of
new macrofinancial policies.
Elizabeth Jane Casabianca (Prometeia
Associazione et Université Polytechnique des Marches, Michele Catalano
(Prometeia Associazione), Lorenzo Forni (Prometeia Associazione et Université
de Padoue), Elena Giarda (Prometeia Associazione et Université de Modène et
d’Émilie) et Simone Passeri (Prometeia Associazione) : An early warning system for banking crises: From regression-based
analysis to machine learning techniques
Amat Adarov (Vienna
Institute for International Economic Studies) : Financial cycles in Europe: Dynamics, synchronicity and implications
for business cycles and macroeconomic imbalances.
Robert Unger (Deutsche Bundesbank) : Revisiting the finance and growth nexus – A
deeper look at sectors and instruments.
Beau Soederhuizen, Rutger Teulings et Rob
Luginbuhl (CPB) : Estimating the impact of the financial cycle on fiscal policy.
Pedro Gomes (Birkbeck et University of
London) et Felix Wellschmied (University Carlos III Madrid) : Public-sector
employment over the life
Harris Dellas (Université de Berne), Dimitris Malliaropulos
(Banque de Grèce et Université du Pirée), Dimitris Papageorgiou (Banque de
Grèce) et Evangelia Vourvachaki (Banque de Grèce) : Fiscal multipliers with an informal sector.
Salvador Barrios (Commission européenne, Centre Commun de
Recherche), Adriana Reut, (Commission européenne, DG ECFIN), Sara Riscado
(Commission européenne, Centre Commun de Recherche et Ministère des finances
portugais) et Wouter van der Wielen (Commission européenne, Centre Commun de
Recherche) : Dynamic
scoring of tax reforms in real time
Sebastian Weiske et Mustafa Yeter (Conseil allemand des experts
économiques) : An evaluation of
different proposals for a European fiscal capacit.y
Kieran McQuinn
et Petros Varthalitis (ESRI et Trinity College Dublin) : How openness to
trade rescued the Irish economy.
Cian Allen (Trinity College Dublin) : Revisiting external imbalances: Insights
from sectoral accounts.
Pascal Jacquinot (Banque centrale européenne), Matija Losej
(Banque Centrale d’Irlande) et Massimiliano Pisani (Banque d’Italie) : Nobody wins: Protectionism and
(un)employment in a model-based analysis.
John Lewis et Matt Swannell (Banque
d’Angleterre): The macroeconomic determinants of migration.
Tatiana
Cesaroni (Ministère de l’économie et des finances italien, MEF-DT), Enrico
D’Elia (Ministère de l’économie et des finances italien, MEF-DF) et Roberta De
Santis (Istat et LUISS) : Inequality
in EMU: is there a core periphery dualism?
Angelos
Angelopoulos Angelos (Université d’Athènes d’Économie et de Gestion et
Université ouverte de Grèce), Konstantinos Angelopoulos (Université de Glasgow et CESifo),
Spyridon Lazarakis (Université de Glasgow), Apostolis Philippopoulos (Université d’Athènes d’Économie et de
Gestion et CESifo) : Rent seeking worsens economic outcomes and
increases wealth inequality.
Tryfon Christou (Université d’Athènes d’Économie et de Gestion),
Apostolis Philippopoulos, (Université d’Athènes d’Économie et de
Gestion et CESifo) et Vanghelis Vassilatos (Université d’Athènes
d’Économie et de Gestion) : Modeling
rent seeking activities: quality of institutions, macroeconomic
performance.
[1]
EUROFRAME est un
réseau d’instituts économiques européens qui regroupe : DIW Berlin et IfW Kiel
(Allemagne), WIFO (Autriche), ETLA (Finlande), OFCE (France), ESRI (Irlande),
PROMETEIA (Italie), CPB (Pays-Bas), CASE (Pologne) et NIESR (Royaume-Uni).
Depuis 2004, EUROFRAME organise chaque année un colloque sur un sujet important
pour les économies européennes. Cette année, 27 contributions de chercheurs ont
été présentées, dont la plupart sont disponibles sur la page web
du colloque.