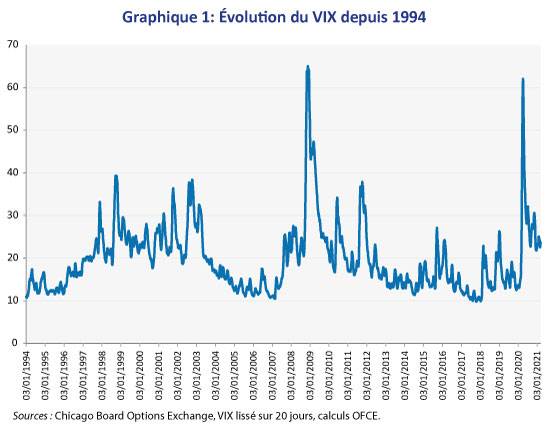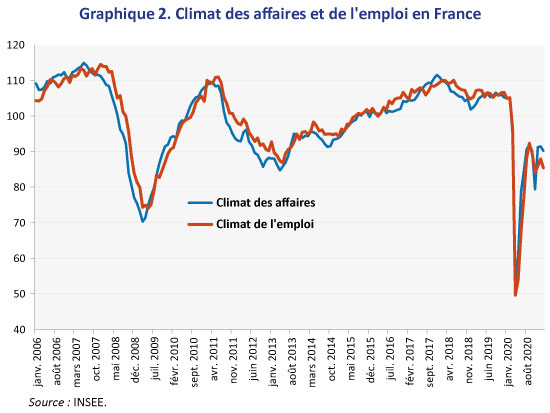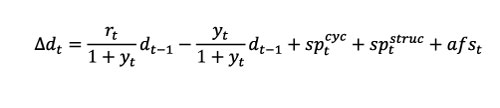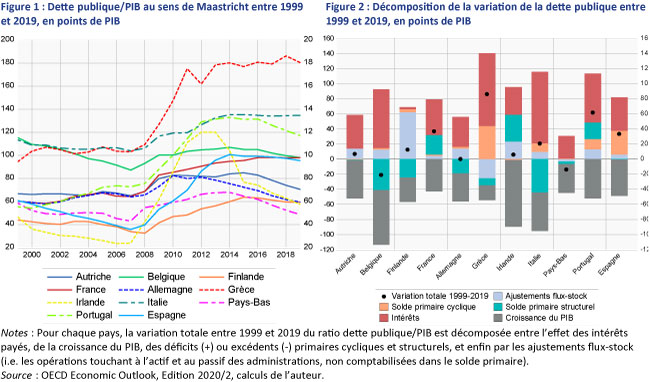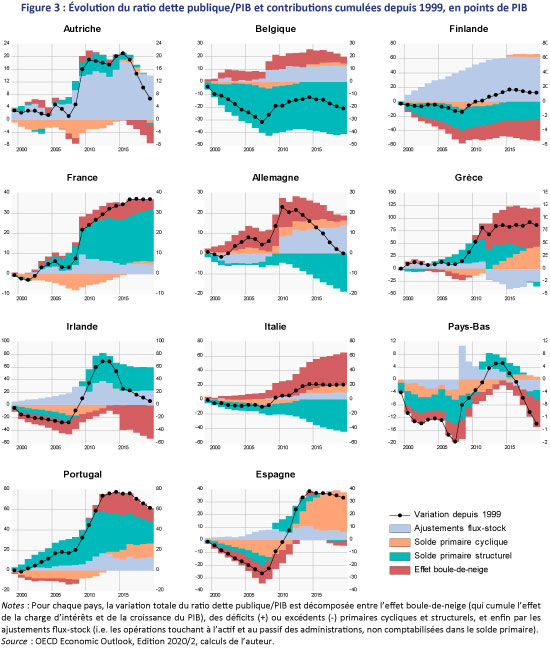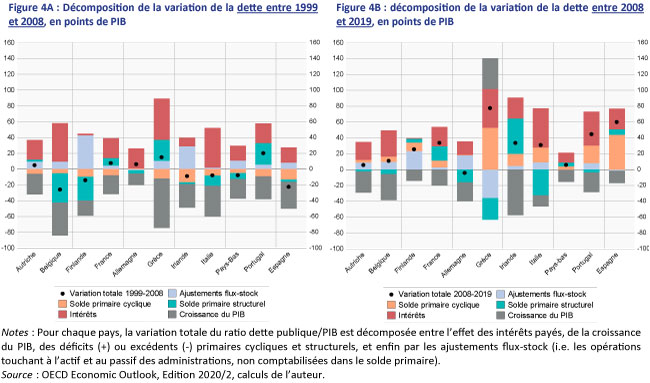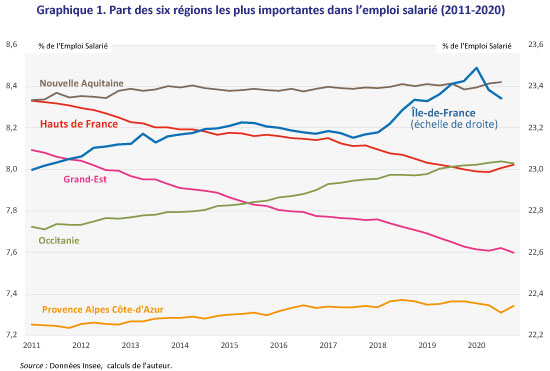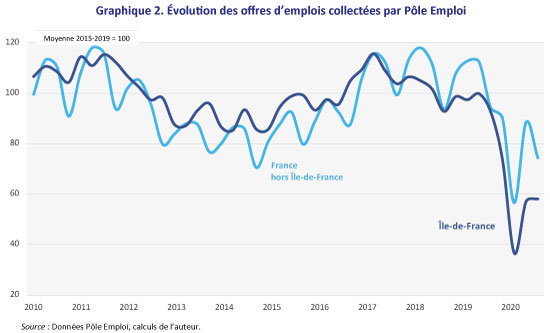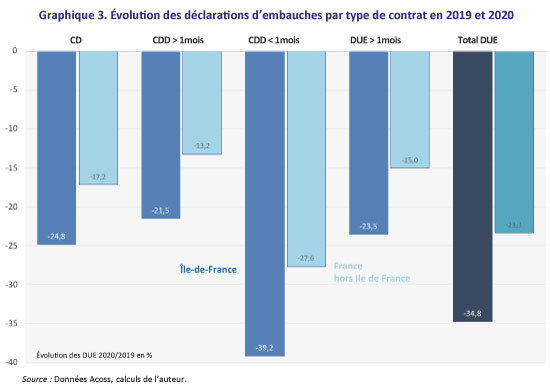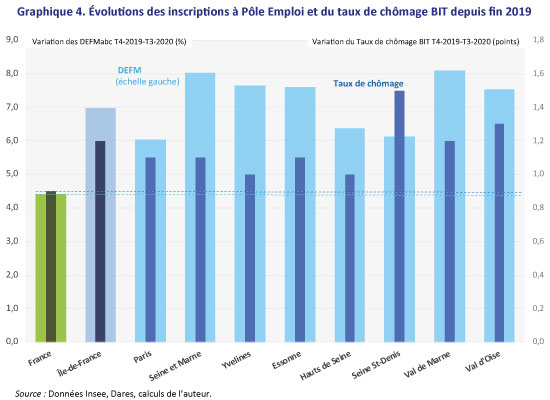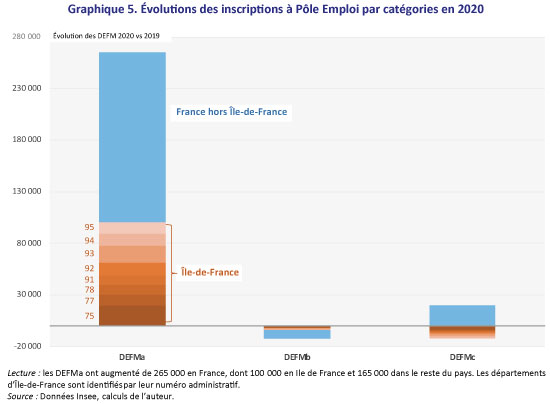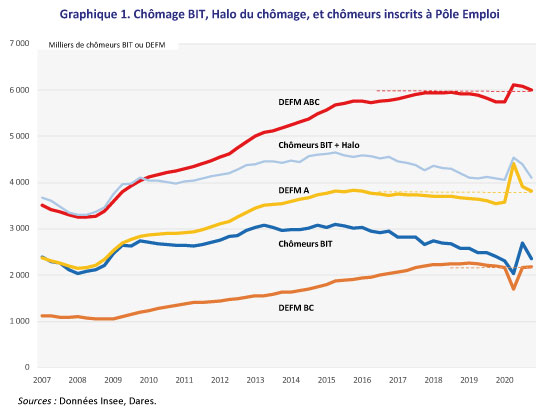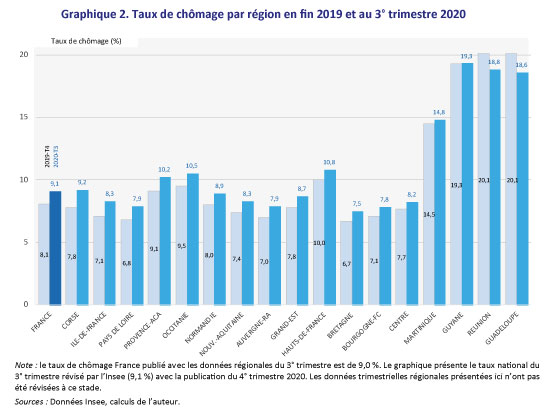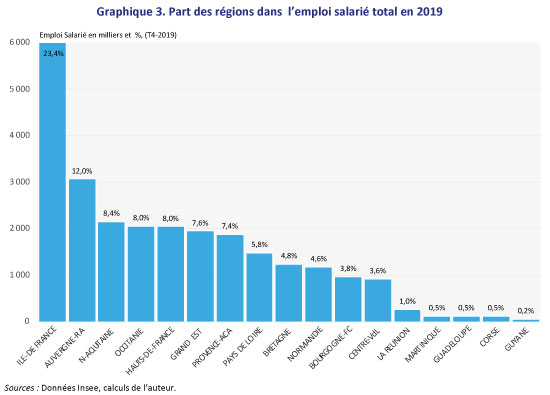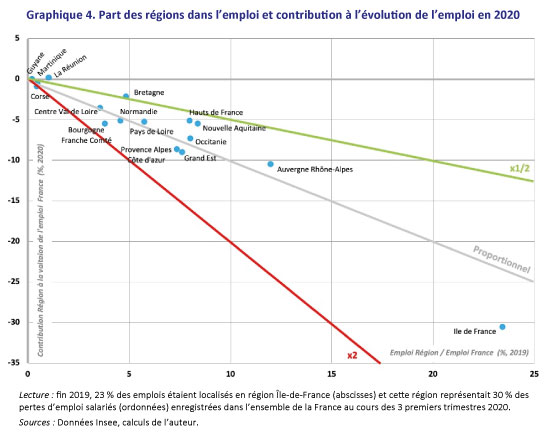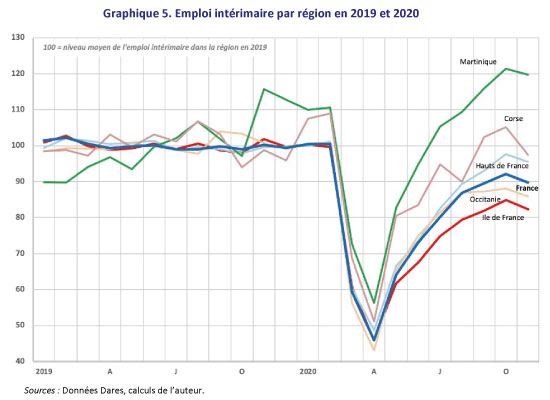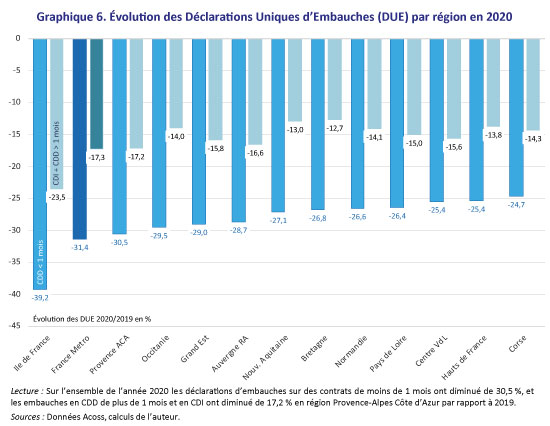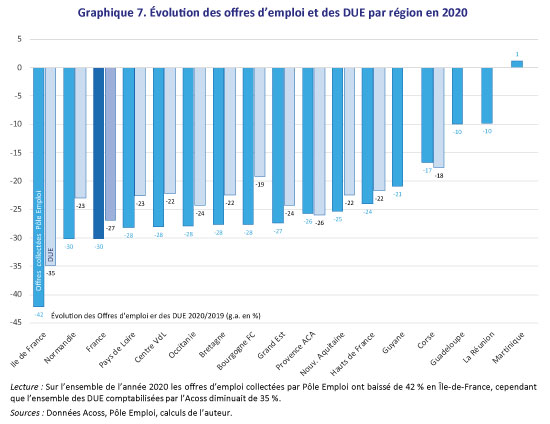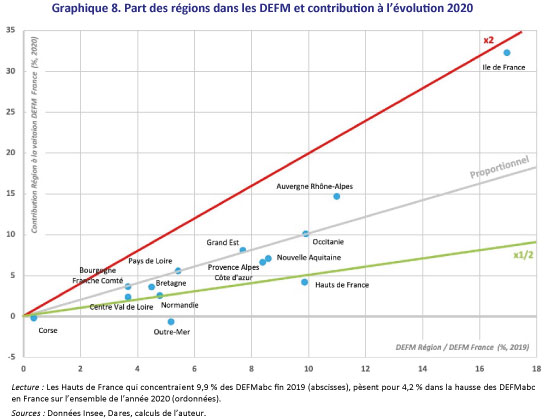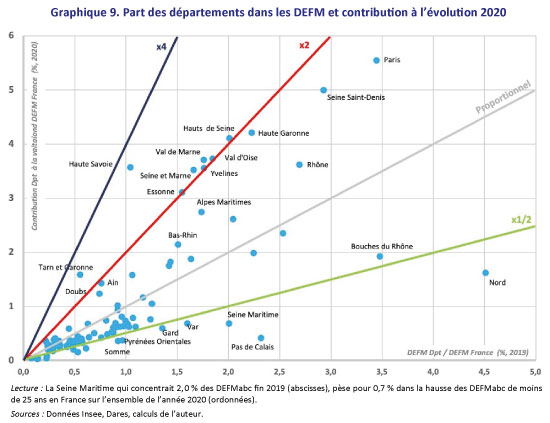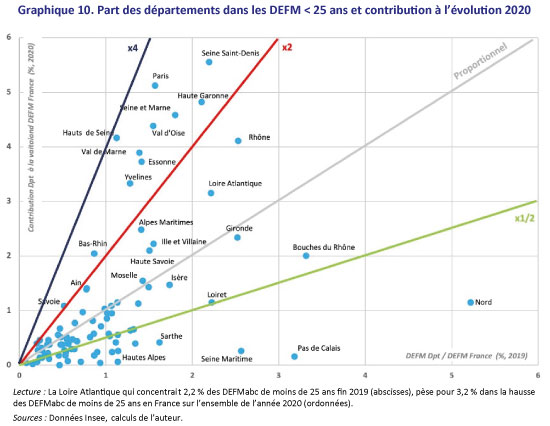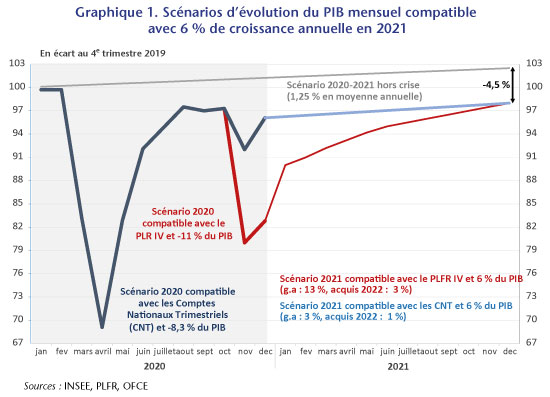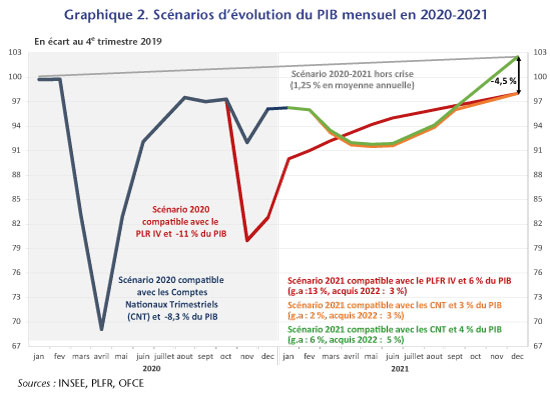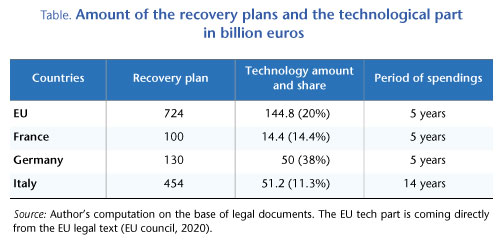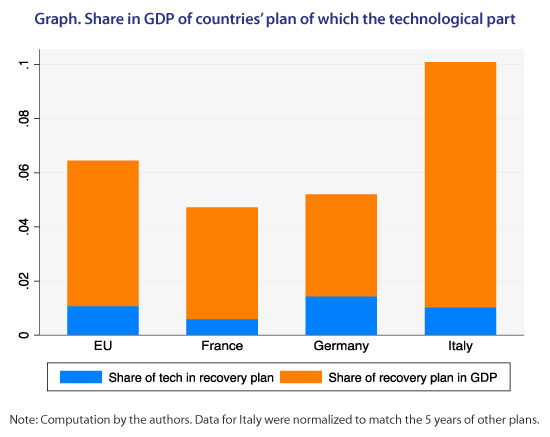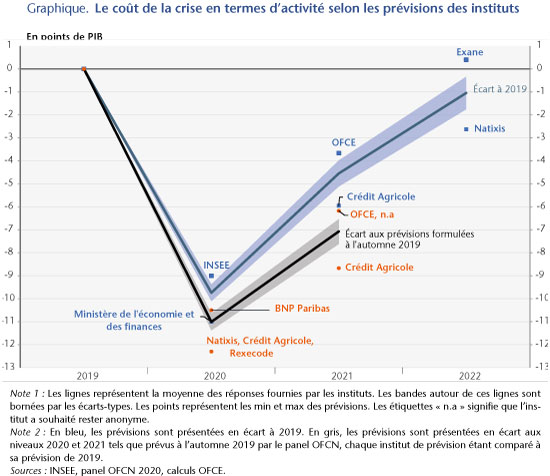Dispersion des marges des entreprises à l’international
Stéphane Auray
et Aurélien Eyquem
La forte mondialisation des économies a accru
l’intérêt que l’on se doit de porter à l’importance des marges bénéficiaires
des entreprises tournées vers l’international. Il sera entendu par marge
bénéficiaire le différentiel entre le coût marginal de production et le prix de
vente. Les évidences empiriques s’accumulent pour montrer que ces marges ont beaucoup
augmenté ces dernières années (Autor, Dorn, Katz, Patterson, et Reenen, 2017 ;
Loecker, Eeckhout, et Unger, 2020) et que les grandes entreprises représentent
une part croissante des fluctuations agrégées (Gabaix, 2011). Par ailleurs, la
dispersion des marges bénéficiaires est considérée dans la littérature comme
une source potentielle de mauvaise allocation des ressources – capital et
travail –, que ce soit au sein d’économies considérées fermées aux échanges
internationaux (voir Restuccia et Rogerson, 2008) ou encore, par exemple, Baqaee
et Farhi, 2020) mais également au sein des économies considérées ouvertes aux
échanges commerciaux (Holmes, Hsu et Lee, 2014 ou Edmond, Midrigan et Xu, 2015).
Enfin, il a été montré récemment par Gaubert et Itskhoki (2020) que ces marges sont
un déterminant essentiel de l’origine granulaire – liée à l’activité des
grandes firmes exportatrices – des avantages comparatifs, autrement dit un déterminant
de la compétitivité dans les échanges.
Dans un article récent (Auray et Eyquem, 2021) nous
introduisons une dispersion des marges bénéficiaires en supposant une
tarification stratégique via une concurrence
à la Bertrand dans un modèle à deux
pays avec effets de variété endogène et commerce international à la Ghironi et Melitz (2005). Notre but
est de comprendre l’interaction entre ces marges, la productivité des
entreprises et les phénomènes d’entrée et de sortie sur les marchés domestiques
comme étrangers. S’il existe des distorsions dans l’allocation des ressources,
comme c’est généralement le cas dans ces modèles, notre objectif corollaire est
d’étudier la mise en œuvre de politiques fiscales optimales.
Dans les modèles à firmes hétérogènes tels que celui
de Ghironi et Melitz (2005), les firmes sont supposées hétérogènes en termes de
productivité individuelle. Les firmes les plus productives sont plus
susceptibles d’entrer sur les marchés parce qu’elles sont plus à même de payer
les coûts fixes d’entrée, que ce soit sur les marchés locaux ou à
l’exportation. Par ailleurs ces firmes étant plus efficaces, elles produisent à
des coûts plus faibles, ce qui leur permet de s’arroger de plus grandes parts
de marché. Ces effets qui semblent relativement intuitifs ont déjà été
largement validés empiriquement. De manière générale, l’introduction de
comportements de tarification stratégique permet aux entreprises ayant les plus
grandes parts de marché de bénéficier d’un plus grand pouvoir de fixation des
prix qui les conduit à extraire des marges plus importantes – étant entendu que
les prix de vente qui en résultent peuvent quant à eux se révéler inférieurs à
ceux de leurs concurrents. Une littérature croissante sur le commerce
international souligne l’importance de ces comportements stratégiques et de la
dispersion des marges qui en résulte dans la détermination des schémas
d’ouverture au commerce ou de leur composition sectorielle (voir par exemple
Bernard, Eaton, Jensen et Kortum, 2003) ; Melitz et Ottaviano, 2008 ;
Atkeson et Burstein, 2008) mais dans l’ampleur des gains de bien-être liés au commerce
(Edmond, Midrigan et Xu, 2015). En effet, l’ouverture au commerce, au-delà de
ses effets habituels, pourrait réduire les effets néfastes de la dispersion des
marges via l’augmentation de la
concurrence qui en résulte et donc accroître ses effets positifs.
Tout d’abord et tel qu’anticipé, lorsque la politique fiscale est passive, la concurrence à la Bertrand génère une répartition des marges telle que les entreprises de plus grande taille – donc les productives – proposent des tarifications plus faibles, attirent des parts de marché plus importantes et obtiennent des marges bénéficiaires plus importantes. De plus, Le mécanisme de sélection des entreprises exportatrices décrit par Melitz (2003) implique que ces dernières sont plus productives et facturent donc des marges bénéficiaires plus élevées. Ces résultats sont intuitifs et correspondent à la distribution observée des marges (voir Holmes, Hsu,et Lee, 2014).
Deuxièmement, nous caractérisons l’allocation optimale des
ressources et montrons comment elle peut être mise en œuvre. Le meilleur
équilibre possible corrige intégralement les distorsions de prix, implique une
dispersion nulle des marges et un niveau quasi-nul de ces marges. Il est mis en
œuvre, comme souvent dans cette littérature, par de généreuses subventions qui
annulent les marges tout en préservant l’incitation des entreprises à entrer
sur les marchés nationaux et d’exportation, c’est-à-dire en leur permettant de
couvrir les coûts fixes d’entrée. Cet équilibre de premier rang peut être mis
en place en utilisant une combinaison de subventions des ventes spécifiques à chaque
entreprise, un régime d’imposition des bénéfices différencié entre entreprises
non-exportatrices et exportatrices et une fiscalité spécifique sur travail.
Dans un modèle similaire où les marges sont supposées
identiques à toutes les entreprises, le meilleur équilibre est identique mais,
en revanche, beaucoup plus facile à mettre en œuvre grâce à un seul instrument de
politique économique : une subvention uniforme et variable dans le temps pour
toutes les entreprises.
Dans les deux cas, les gains associés à de telles politiques
sont très importants par rapport au laisser-faire, représentant un
accroissement potentiel de la consommation des ménages de l’ordre de 15%. Cependant,
compte tenu de la complexité de la mise en œuvre d’un régime avec des marges hétérogènes
et au regard de son coût pour les finances publiques, supérieur à 20% du PIB –
la mise en œuvre nécessite d’importants montants de subventions, que les marges
soient hétérogènes ou homogènes – nous considérons les politiques alternatives
de second rang, où le nombre d’instruments de politique économique est limité
et où l’on impose que le budget du gouvernement soit équilibré. Nous constatons
que ces restrictions réduisent considérablement la capacité des décideurs à
réduire les pertes de bien-être associées à l’équilibre de laisser-faire, et
que seulement un tiers des gains potentiels de bien-être peuvent être mis en
œuvre dans ce cas.
Troisièmement, alors que les allocations de premier rang
sont indépendantes du degré du comportement de tarification, nous constatons
que les pertes de bien-être observées dans l’équilibre de laisser-faire sont
inférieures lorsque les marges sont hétérogènes et supérieures en moyennes aux
marges observées en l’absence de tarification stratégique. Même si cela peut
sembler surprenant, le résultat peut être rationalisé en considérant les effets
de la dispersion des marges à la fois sur la marge intensive – quantité produite
par entreprise – et sur la marge extensive – le nombre d’entreprises sur les
marchés. En effet, la concurrence à la
Bertrand implique que la dispersion et le niveau moyen des marges sont
positivement liés. La dispersion des marges augmente ainsi le niveau des marges
avec deux effets. D’une part, toutes choses égales par ailleurs, des marges plus
élevées réduisent la quantité produite par chaque entreprise – la marge
intensive – et induisent une mauvaise allocation des ressources qui génère des
pertes de bien-être. D’autre part, des marges bénéficiaires plus élevées
impliquent des bénéfices attendus plus élevés pour les entrants potentiels, ce
qui stimule l’entrée et augmente ainsi le nombre d’entreprises existantes – la
marge extensive. Selon notre modèle, les gains de bien-être associés au second
effet dominent les pertes de bien-être associées au premier effet. Le résultat
implique donc que la dispersion des marges bénéficiaires peut générer des gains
de bien-être, du moins lorsque aucune autre politique fiscale ou industrielle
n’est menée.
Quatrièmement, alors que les résultats précédents sont
principalement concentrés sur les implications de notre modèle et des
politiques optimales associées en moyenne au cours du temps, nous étudions
également les leurs propriétés dynamiques. Dans le cadre de politiques fiscales
passives (laisser-faire), lorsque l’économie subit des chocs de productivité
agrégés – technologiques par exemple – le modèle se comporte globalement comme
le modèle à la Ghironi et Melitz (2005). Une prédiction originale de notre
modèle est que les marges bénéficiaires sont globalement contracycliques tandis
que les marges bénéficiaires à l’exportation sont procycliques. La politique
optimale implique des ajustements des taux d’imposition afin de renverser cette
tendance, d’aligner toutes les marges au long du cycle économique et de rendre
toutes les marges procycliques. Ces résultats sont conformes aux conclusions des
études qui concentrent le comportement cyclique optimal des marges avec firmes
hétérogènes dans des modèles d’économies fermées (Bilbiie, Ghironi et Melitz,
2019) et ouvertes (Cacciatore et Ghironi, 2020). Pour autant, conditionnellement
à des chocs de productivité agrégés, la dispersion des marges bénéficiaires a
peu d’effets quantitativement en comparaison d’un modèle similaire avec marges
homogènes.
Enfin, dans l’esprit de Edmond, Midrigan et Xu (2015), nous
menons une expérience de libéralisation commerciale par laquelle les coûts du
commerce diminuent progressivement et définitivement à presque zéro. Nous
constatons que les gains de bien-être à long terme sont beaucoup plus
importants lorsque la politique conduite est optimale. D’autre part,
l’équilibre de laisser-faire indique que les gains de bien-être à court terme
sont affectés par la dispersion des marges. En effet, la dispersion des marges
affecte la dynamique de création des entreprises résultant d’une libéralisation
des échanges de manière critique. Comme dans Edmond, Midrigan et Xu (2015), la
dispersion des marges réduit les gains de bien-être à long terme du commerce,
mais pour une raison différente : elle affecte le dynamisme dans la création d’entreprises
et réduit le nombre d’entreprises à long terme. Cependant, puisque dans ce cas,
moins de ressources sont investies à court terme pour créer de nouvelles
entreprises, la consommation augmente davantage à la marge intensive à court et
moyen termes – moins de 10 ans. Alors que les gains de bien-être à long terme
de l’intégration commerciale varient de 12% à 14,5% selon les étalonnages, les
gains de bien-être à court terme avec marges hétérogènes peuvent être jusqu’à 3%
plus importants qu’avec marges homogènes.
Les conclusions de cette étude conduisent à une
approche plus nuancée des marges bénéficiaires des entreprises que celle
habituellement avancée par la littérature. En effet, si ces marges et leur
dispersion ont bien des effets négatifs sur l’économie, elles ont également un
rôle important à jouer dans les phénomènes d’entrée de firmes et de
participation aux marchés internationaux. Nos travaux viennent en complément
d’une approche strictement microéconomique des questions de politique
industrielle, qui conclurait de manière univoque quant à la nocivité des
pouvoirs de marchés à l’origine de ces marges. À ce titre, à la manière de
Schumpeter, ils convoquent une vision plus équilibrée du rôle des marges des
entreprises dans les économies modernes qui ferait état d’une tension entre
distorsions de concurrence et incitations à la création d’entreprises.
Références bibliographiques
Auray
Stéphane et Aurélien Eyquem, 2021, « The dispersion of Mark-ups in an Open Economy ».
Autor
David, David Dorn, Lawrence F. Katz, Christina Patterson et John Van Reenen,
2017, « Concentrating
on the Fall of the Labor Share », American
Economic Review, 107 (5):180-185.
Baqaee
David Rezza et Emmanuel Farhi, 2020, « Productivity and Misallocation in General Equilibrium », The Quarterly Journal of Economics, 135
(1):105-163.
Berman N.,
P. Martin et T. Mayer, 2012, « How do Different Exporters React to Exchange Rate Changes? », Quarterly Journal of
Economics, 127 (1):437-492.
Bernard
Andrew B., Jonathan Eaton, J. Bradford Jensen et Samuel Kortum, 2003, « Plants and Productivity in
International Trade », American Economic Review, 93 (4):1268-1290.
Bilbiie
Florin O., Fabio Ghironi et Marc J. Melitz, 2008, « Monetary Policy and Business Cycles with
Endogenous Entry and Product Variety », In NBER
Macroeconomics Annual 2007, Volume 22, NBER Chapters. National Bureau of
Economic Research, Inc, 299-353.
Bilbiie
Florin O., Fabio Ghironi et Marc J. Melitz, 2019, « Monopoly Power and Endogenous
Product Variety: Distortions and Remedies », American
Economic Journal: Macroeconomics, 11 (4):140-174.
Cacciatore
Matteo, Giuseppe Fiori et Fabio Ghironi, 2016, « Market Deregulation and Optimal Monetary Policy
in a Monetary Union », Journal of International
Economics, 99 (C):120-137.
Cacciatore
Matteo et Fabio Ghironi, 2020, « Trade, Unemployment, and Monetary Policy », NBER Working Paper, 27474.
Edmond
Chris, Virgiliu Midrigan et Daniel Yi Xu, 2015, « Competition, Markups, and the Gains from
International Trade », American Economic Review, 105(10):3183-3221.
Etro
Federico et Andrea Colciago, 2010, « Endogenous Market Structure and the Business Cycle », Economic Journal, 120(549):1201-1233.
Gabaix
Xavier, 2011, « The
Granular Origins of Aggregate Fluctuations », Econometrica, 79(3):733-772.
Gaubert
Cecile et Oleg Itskhoki, 2020, « Granular Comparative Advantage », Journal of
Political Economy (à paraître).
Ghironi F. et
M. J. Melitz, 2005, « International Trade and Macroeconomic Dynamics with Heterogeneous Firms », Quarterly Journal of Economics,
120(3):865-915.
Holmes
Thomas J., Wen-Tai Hsu et Sanghoon Lee, 2014, « Allocative Efficiency, Mark-ups, and the
Welfare Gains from Trade », Journal of International Economics, 94(2):195-206.
Loecker Jan
De, Jan Eeckhout et Gabriel Unger, 2020, « The Rise of Market Power and the Macroeconomic
Implications [“Econometric Tools for Analyzing Market Outcomes”] », The Quarterly Journal of
Economics, 135(2):561-644.
Melitz Marc
J., 2003, « The
Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity », Econometrica, 71(6):1695-1725.
Melitz Marc
J. et Gianmarco I. P. Ottaviano, 2008, « Market Size, Trade, and Productivity », Review of Economic Studies, 75(1):295-316.
Restuccia
Diego et Richard Rogerson, 2008, « Policy Distortions and Aggregate Productivity with
Heterogeneous Establishments »,
Review of Economic
Dynamics, 11(4):707-720.