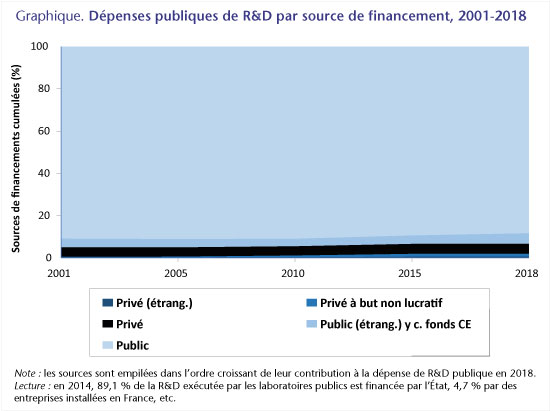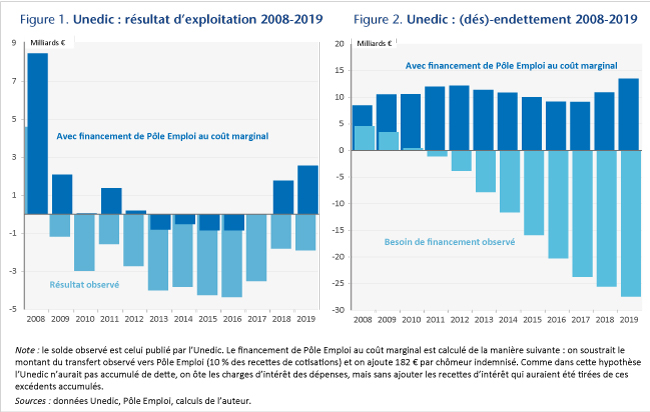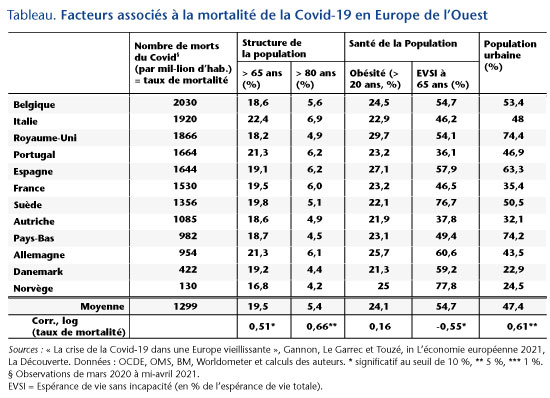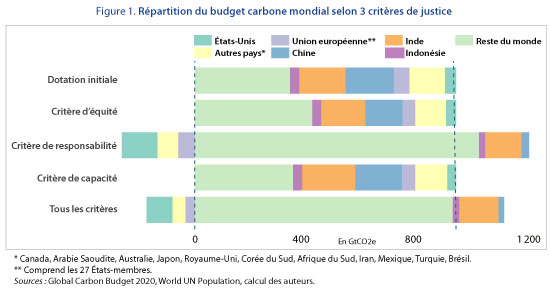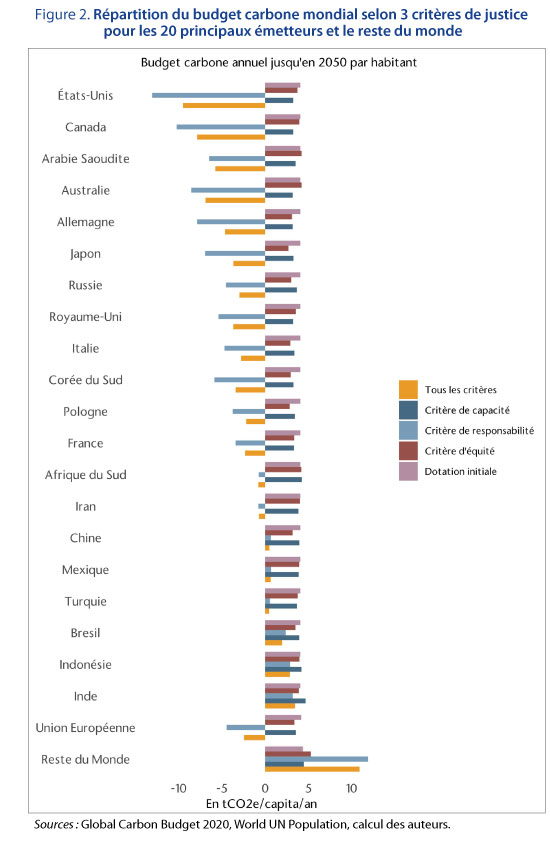Le défi de l’instabilité
par Jean-Luc Gaffard
Un grand désordre existe dans la pensée
économique confrontée à la conjonction de crises financière, sanitaire et
écologique. L’idée continue de dominer que ce ne sont là que de simples
parenthèses que l’on devrait pouvoir refermer plus ou moins vite. Pourtant
l’hypothèse d’une profonde transformation du modèle économique n’est pas dénuée
de fondements. À tout le moins, il va falloir accepter que se profile une
accélération des processus de destruction créatrice et de recomposition du
tissu productif qui va se traduire par la formation et l’enchaînement de
déséquilibres sur les différents marchés. Les économistes ne sont pas démunis
de références face à cette réalité s’ils veulent bien retenir les enseignements
tirés de l’observation et de l’analyse d’événements faisant suite à des
ruptures importantes dans le passé, allant à l’encontre de bien d’idées reçues.
La
croyance dans une parenthèse ou le retour en arrière fantasmé
La crise sanitaire a conduit les
gouvernements à prendre une décision administrative exceptionnelle d’arrêt de
l’activité économique assortie de mesures destinées à préserver les revenus de
salariés placés en chômage partiel et à prémunir les entreprises de tomber en
faillite. L’objectif plus ou moins avoué est de se placer dans les conditions
de revenir plus ou moins rapidement au niveau d’activité d’avant-crise.
L’attente d’un retour à la
« normale » favorisé par un gel des effets sur les revenus est censé
être conforté grâce à l’adoption et la mise en œuvre de plans de relance
incluant, entre autres, des mesures visant à accélérer la transition digitale
et la transition écologique. L’usage des modèles économétriques suggère qu’il
est ainsi possible de retrouver l’équilibre perdu en termes de croissance.
Ce retour à la « normale » serait
inscrit dans le surcroît d’épargne censé venir alimenter une reprise de la
consommation à plus ou moins brève échéance obéissant à des préférences
largement inchangées. Il serait permis par la création de dettes sous l’égide
des banques centrales, abandonnant un temps les politiques conventionnelles,
qui doivent doper un redémarrage rapide après avoir contenu les effets
délétères de l’arrêt d’activité. Il existerait un lien direct et unique entre
finance et économie réelle. La liquidité abondamment distribuée, d’abord gelée
sur les comptes des épargnants, se dirigerait, ensuite, naturellement vers la
consommation et l’investissement.
Dans une approche trop exclusivement
macroéconomique, impasse est faite sur la distribution très inégalitaire de ce
surcroît d’épargne qui a forcément des effets sur la structure de la demande
finale pouvant impliquer que plus de certains biens et services et moins
d’autres seront demandés. Impasse est faite, également, sur la formation d’une
épargne de précaution liée à l’incertitude de ceux des ménages qui s’attendent
à être plus touchés que les autres par des chutes d’emplois dans un futur
immédiat. Impasse est faite sur les contraintes de capacité à court terme face à
un rebond assez brutal et inégalement réparti de la demande, que ce soit en
raison d’un manque de main-d’œuvre, ou du fait de contraintes d’endettement
pesant sur l’investissement des entreprises. Plus généralement, impasse est
faite sur la bascule affectant les lieux sectoriels et géographiques de captation
de richesse.
Le gel temporaire d’activité et la croyance
en un retour mécanique à la « normale » conduisent à ignorer l’impact
de déséquilibres de court terme sur le développement à moyen ou long terme. Les
conséquences, à relativement brève échéance, de l’endettement des entreprises
ne sont guère identifiables tant les mécanismes de sélection ont été modifiés.
Nul n’est en mesure de dire vraiment ce qu’il va advenir en termes de faillites
d’entreprises et de perte d’emplois Le risque inflationniste, envisagé par
certains, n’est appréhendé qu’au regard d’un financement monétaire des déficits
publics sans réelle tentative d’analyser la séquence des événements à venir nés
de l’articulation entre action publique et activité privée. L’hétérogénéité des
situations et des comportements est passée sous silence.
Le discours sur le monde d’après tel qu’envisagé
par ceux qui entendent saisir l’opportunité de la crise pour accélérer la
transition écologique n’échappe pas l’illusion d’une convergence sans
véritables heurts vers un nouvel équilibre. Celui-ci est inscrit dans de
nouvelles technologies et de nouveaux comportements sans que soient considérés
les moyens de les connaître et de les atteindre. La relocalisation souhaitée
d’activités et la régression attendue des échanges à l’échelle mondiale s’apparentent
à une sorte de retour en arrière que l’on imagine sans coûts ni dommages.
L’hypothèse
du changement structurel de grande ampleur
La réalité est que la crise sanitaire n’est,
pourtant, pas intervenue dans un monde économique stable. Des mutations
structurelles étaient à l’œuvre dont on peut penser qu’elles vont se trouver
accélérées du fait de l’expérience acquise dans la gestion de cette crise et de
ses contraintes (Dessertine, 2021).
L’expérience du télétravail augurerait
d’une transformation en profondeur de l’organisation du travail et de
l’entreprise, qui serait elle-même à l’origine d’une transformation des
infrastructures urbaines et de transport. Ces transformations seraient d’autant
plus importantes qu’elles participent d’une nouvelle révolution scientifique et
technologique incarnées dans les nouvelles capacités de captation, de
traitement et d’usage de très grandes bases de données (le « big
data »). Dans cette perspective, la révolution digitale devient beaucoup
plus importante que la révolution énergétique, les producteurs de données prennent
le pas sur les producteurs d’énergies anciennes et nouvelles, les lieux de
création de valeur changent drastiquement. Il pourrait s’ensuivre un retour de
certaines productions à proximité de leurs marchés, une régression des mouvements
de marchandises et d’êtres humains permettant, au passage, de réduire les coûts
environnementaux. Le triptyque mouvement – concentration – hyper-consommation
ne permettant pas un développement durable serait ainsi remis en cause. Encore
faudrait-il que puisse prévaloir une relative égalité de revenus et de
patrimoines, que renaisse une véritable classe moyenne pour que le changement
soit admis socialement et soit créateur de valeur.
Le grand basculement ainsi envisagé ne
remet pas en cause le principe du monde industriel, celui d’une organisation
maximisant le taux d’utilisation des fonds de services (équipements, ressources
humaines, stocks), synchronisant les étapes successives de la production de
biens et de services (Georgescu-Roegen, 1971). La concentration géographique
n’est plus nécessaire pour y parvenir. Les grandes unités n’ont plus lieu
d’être. Cette déconcentration est susceptible de réduire la longueur des
acheminements (les transports de matières et de produits) sans que l’efficacité
productive en soit affectée. Il reste que les mutations structurelles en
question sont de très grande ampleur. De nouvelles communautés, de nouvelles
intelligences collectives vont devoir s’organiser. L’entreprise va devoir
acquérir de nouveaux contours. Les lieux de captation de valeur, tels que les
enregistrent les mouvements boursiers, évoluent déjà fortement au bénéfice des
acteurs du numérique. Il est difficile, dans ces conditions, d’imaginer que
l’instabilité ne soit pas au rendez-vous rendant illusoire toute possibilité
d’un retour à la « normale ».
Sans
aller aussi loin dans la prospective …
Les mutations en cours, affectant
technologies et préférences, restent difficiles à connaître et à prévoir. Elles
ne se dérouleront pas en un jour. Rien n’indique qu’un nouvel état stable
puisse même exister. Il est, en revanche, manifeste, que l’on va assister à une
accélération de la recomposition du tissu productif en raison des effets
combinés de la crise sanitaire et de la crise écologique. Les nouvelles donnes
technologiques et comportementales vont entraîner une accélération du processus
de destruction créatrice. Des secteurs sont d’ores et déjà durablement affectés
par les transformations de la demande tels que le transport aérien ou l’automobile
qui ne sont pas confrontés aux seules conséquences de la transition énergétique.
Sans compter bien sûr les effets en amont comme en aval. Il ne peut être
question d’un retour à un équilibre de longue période effaçant les pertes
subies. Si des relocalisations d’activité se produisent, ce ne sera pas sous la
forme d’un retour à l’identique, mais sur la base de robotisation sans création
de « vieux » emplois pouvant résorber le chômage structurel. Plutôt
que de relocalisation et de raccourcissement des chaînes de valeur, il vaut
mieux parler de leur recomposition, d’un changement de nature de la
mondialisation des échanges.
Les mutations en cours affectent, en tout
premier lieu, la situation des marchés. Excès et pénuries de main-d’œuvre pourraient
s’accentuer du fait de l’hétérogénéité de l’offre de travail et d’une mobilité
professionnelle freinée par un défaut de temps et de moyens financiers
d’apprentissage. Le risque d’une polarisation encore accrue des emplois en
termes de qualification et de salaires est manifeste du fait de la rareté de
l’offre de travail qualifiée et du déversement de la main d’œuvre la plus
touchée vers les emplois peu qualifiés. Ce
ne peut être que dommageable à la croissance globale en raison de l’effet
produit sur la répartition des revenus et la structure de la demande
possiblement caractérisée par une demande accrue de biens de luxe et d’actifs
financiers au détriment d’une forte demande de biens « salariaux »,
caractéristique de l’existence d’une importante classe moyenne.
Des tensions inflationnistes sont déjà effectives
sur les marchés de matières premières (fer, cuivre, bois, aluminium, blé, soja,
pétrole) et sur les marchés de produits intermédiaires (semi-conducteurs, puces
électroniques), qui vont peser, plus ou moins fortement suivant les secteurs,
sur les coûts de production des entreprises, leurs marges et leurs prix. De
telles tensions sont le fruit des mutations structurelles en cours y compris celles
résultant de la transition écologique. Ainsi à production égale,
l’éolien et le solaire consomment considérablement plus d’acier et de béton que
les centrales thermiques ou nucléaires. L’électrification des objets, à
commencer par la voiture, et le besoin en batteries de stockage qu’elle
implique ne peuvent que faire exploser la demande des matériaux qui les
composent et leurs prix.
Des investissements très élevés sont requis
y compris en raison pour des raisons écologiques (économies de ressources). La mutation
ainsi engagée, comme toute transition, entraîne une hausse des coûts de
construction des nouvelles capacités et, potentiellement une chute relative du
produit brut avec comme conséquence, temporairement ou non, la hausse du taux
de chômage et la diminution des gains de productivité (l’effet machine de
Ricardo décrit par Hicks, 1973). Y parer requiert, à tout le moins, une
politique monétaire et une organisation financière garantissant aux entreprises
un accroissement des crédits à l’investissement productif (Amendola et Gaffard,
1998).
Face à l’inévitabilité des mutations
structurelles et à l’exigence de viabilité, il devient essentiel de développer
de nouvelles qualifications et de nouveaux emplois correctement rémunérés. Ce
n’est pas qu’une affaire d’offre de travail, de formation initiale, générale,
professionnelle et continue. C’est aussi une affaire de demande de travail impliquée
par le développement de nouvelles activités et de nouveaux investissements. La
question se pose alors clairement de l’organisation du système financier et du
mode de gouvernance des entreprises propres à orienter les moyens financiers
disponibles vers les projets les plus porteurs de croissance à long terme dans
la mesure où ils permettent aux entreprises de former des anticipations fiables.
Les économistes sont-ils démunis de repères ?
Ce
n’est pas de la théorie économique conçue pour décrire les périodes de
tranquillité qu’il faut attendre une compréhension des ressorts de l’instabilité
et des conditions de résilience de l’économie de marché. À vrai dire, il vaut mieux
se rapporter aux enseignements tirés de l’observation de périodes passées de
rupture. Deux épisodes retiendront ici l’attention.
L’épisode
des années 1970 livre un premier enseignement dès lors que l’on y
reconnaît un changement structurel de grande ampleur. La hausse simultanée du
taux d’inflation et du taux de chômage a conduit à une remise en cause d’une
politique keynésienne strictement macroéconomique, fondée sur la possibilité
d’un arbitrage maîtrisé entre les deux. L’explication qui l’a emporté a reposé
sur la dénonciation d’un déficit budgétaire venant contrarier un état naturel
d’équilibre de long terme. Le principe de séparation entre causes (monétaires)
de l’inflation et causes (réelles) du chômage a été ainsi réhabilité. La
véritable explication de la stagflation est pourtant différente, mettant l’accent
sur les conséquences de la recomposition du tissu productif initiée par la
hausse très forte du prix de toutes les matières premières avant même que ne
survienne le choc pétrolier. L’augmentation simultanée de l’inflation et du
chômage n’est autre que la conséquence de la désarticulation du tissu productif
que traduit la dispersion accrue des demandes et offres excédentaires
(sectorielles) dans un contexte où, faute d’une information suffisante, les
prix s’ajustent plus fortement à la hausse qu’à la baisse (et les quantités
donc les emplois plus fortement à la baisse qu’à la hausse) (Tobin, 1972 ;
Fitoussi, 1973). En présence d’une demande excédentaire de travail, dans
les activités en essor, les entreprises augmentent plutôt les salaires que
l’emploi en raison de la rareté de l’offre de travail et de l’existence d’une
contrainte de capacité. En présence d’une offre excédentaire de travail, dans
les activités en déclin, les entreprises diminuent plutôt l’emploi que les
salaires pour conserver la confiance des salariés qu’ils continuent à embaucher.
La rigidité des prix répond à celle des salaires. Cette asymétrie de
comportement contraint le niveau global de l’emploi et le taux d’inflation.
L’épisode de la reconstruction en Europe
dans les années de l’après-Seconde Guerre mondiale livre un deuxième
enseignement. La situation globale de l’époque est caractérisée par un excédent
de demande de travail et un excédent de demande de biens. La reconstruction
exige la réalisation d’investissements qui doit permettre de combler le déficit
de capacité. Du pouvoir d’achat sous forme de salaires doit être distribué sans
contrepartie immédiate du côté de l’offre, car il faut du temps pour que
l’investissement soit réalisé et donne lieu à une capacité de production
opérationnelle. Il ne peut en résulter, à court terme, que des tensions
inflationnistes et un déficit du commerce extérieur à la fois inévitables,
nécessaires mais porteurs de leur future extinction (Hicks, 1947). Encore
faut-il qu’ils soient engagés, que les entreprises puissent faire des
anticipations fiables, qu’elles disposent des liquidités nécessaires, ce qu’a
permis le plan Marshall.
S’ils n’offrent pas de solutions toutes
faites, ces enseignements nous éclairent sur la nature des difficultés et
problèmes qui peuvent survenir à plus ou moins brève échéance. Des
déséquilibres ne peuvent qu’apparaître sur les différents marchés (matières
premières, biens intermédiaires et biens finals, travail). Ils ne pourront être
contenus que par des moyens relevant, à la fois, de la politique économique et
de l’organisation des entreprises, permettant de faire face à l’hétérogénéité
des situations et des comportements et de réconcilier le temps long avec le
temps court. L’objectif est de faire en sorte que les anticipations des
entreprises relatives aux investissements soient cohérentes avec les politiques
publiques (Gaffard, Amendola et Saraceno, 2020). Aussi convient-il de revenir à
une problématique en termes de déséquilibre, renoncer à s’en tenir aussi bien à
une politique de l’offre qu’à une politique de la demande pour mettre l’accent
sur l’interdépendance entre l’offre et la demande, au niveau global comme
sectoriel, afin d’identifier les conditions d’une cohérence entre les deux
toujours en devenir. Deux questions fondamentales sont en haut de l’agenda.
Celle de l’incitation à investir et celle conjointe de la relation salariale.
Il s’agit de rechercher les conditions institutionnelles propres à garantir
d’orienter les moyens financiers vers la création une offre correspondant à une
demande finale suffisamment large et à rétablir un partage de la valeur ajoutée
porteur de cette demande. À ces conditions, les choix de politiques
macroéconomiques pourront être en concordance avec les anticipations formulées
par les entreprises comme cela a pu l’être pendant la période dite des
« trente glorieuses » au sein du monde occidental. Reste qu’il faudra
affronter un contexte géopolitique bien différent qui ne se résume pas à la
mondialisation vue comme une extension des marchés.
Références
Amendola M. et J. -L. Gaffard, 1998, Out
of Equilibrium, Oxford, Clarendon Press.
Dessertine P., 2021, Le grand basculement, Paris, Robert Laffont.
Fitoussi J. -P., 1973, Inflation, équilibre et chômage, Paris, Cujas.
Gaffard J. -L. , Amendola M. et F.
Saraceno, 2020, Le temps retrouvé de
l’économie, Paris, Odile Jacob.
Georgescu-Roegen N., 1971, The
Entropy Law and the Economic Process, Harvard, Harvard University Press.
Hicks J. R., 1947, « World Recovery after War: a Theoretical Analysis », The Economic Journal, n° 57, pp. 151-164. Reproduit in J.
R. Hicks, 1982, Money, Interest, and
Wages, Collected Essays on Economic Theory, volume II, Oxford, Basil
Blackwell.
Hicks J. R., 1973, Capital and
Time, Oxford, Clarendon Press.
Tobin J., 1972, « Inflation and Unemployment », American
Economic Review, n° 62, pp. 1-18.