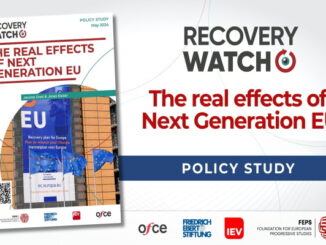
Next Generation EU : quels effets économiques en attendre ?
Jérôme Creel et Jonas Kaiser Dans une étude pour la Foundation for European Progressive Studies (FEPS), nous tentons d’évaluer les effets économiques de Next Generation […]
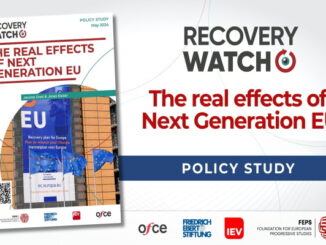
Jérôme Creel et Jonas Kaiser Dans une étude pour la Foundation for European Progressive Studies (FEPS), nous tentons d’évaluer les effets économiques de Next Generation […]

par Mathieu Plane, Xavier Ragot, Raul SampognaroL’évolution de la dette publique française occupe légitimement une place importante dans le débat politique depuis que l’Insee a […]

Cyrille P. Coutansais, Directeur du département Recherches du CESM[1] Intervention à la Journée d’études « IRA vs. NZIA » du 26 avril 2024 à Sciences Po Paris, […]

Sébastien Bock, Aya Elewa, Sarah Guillou, Mauro Napoletano, Lionel Nesta, Evens Salies, Tania Treibich Depuis les premiers travaux de Robert Solow, on sait que la […]

Montserrat Botey et Guillaume Chapelle Ce billet[1] qui reprend les conclusions principales d’un article paru dans Economie et statistique examine le potentiel impact redistributif de […]
Copyright © 2025 | Thème WordPress par MH Themes