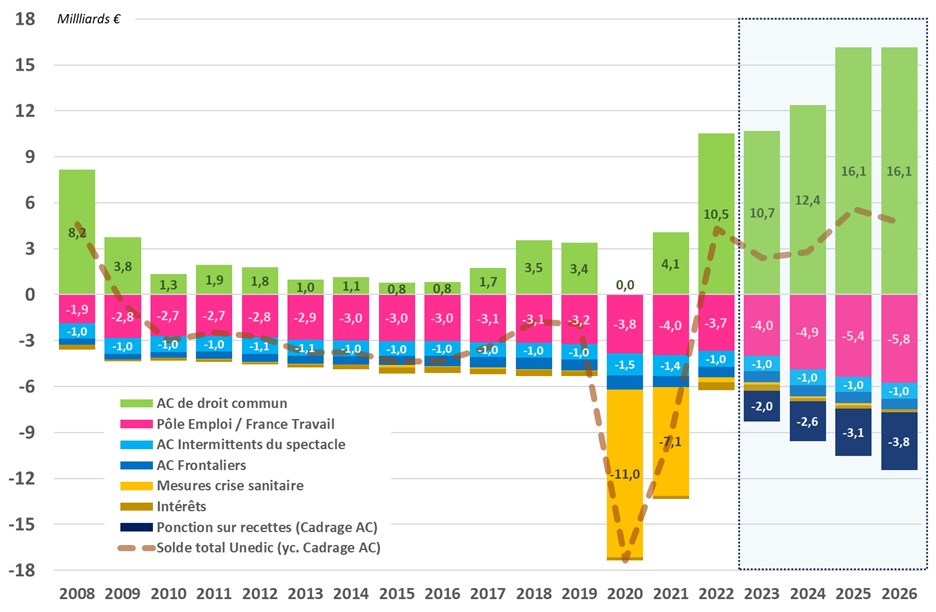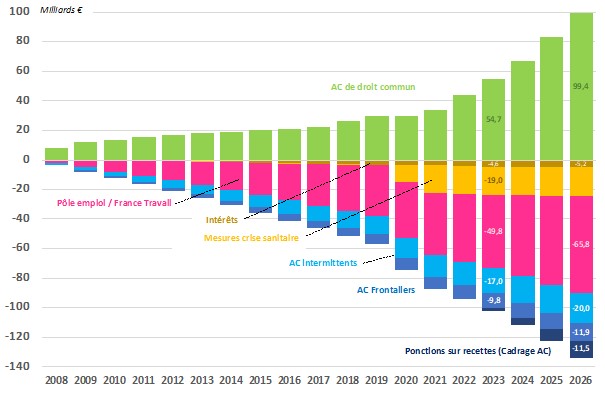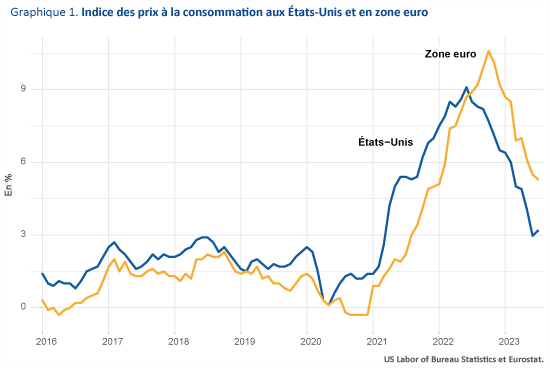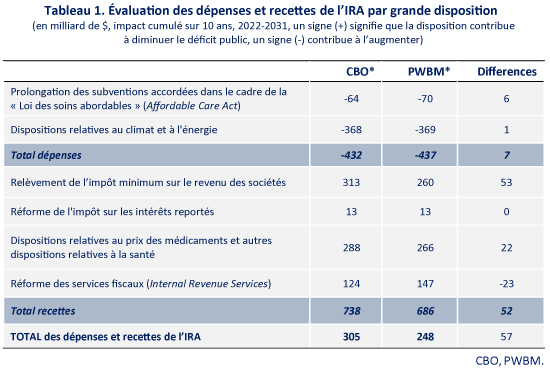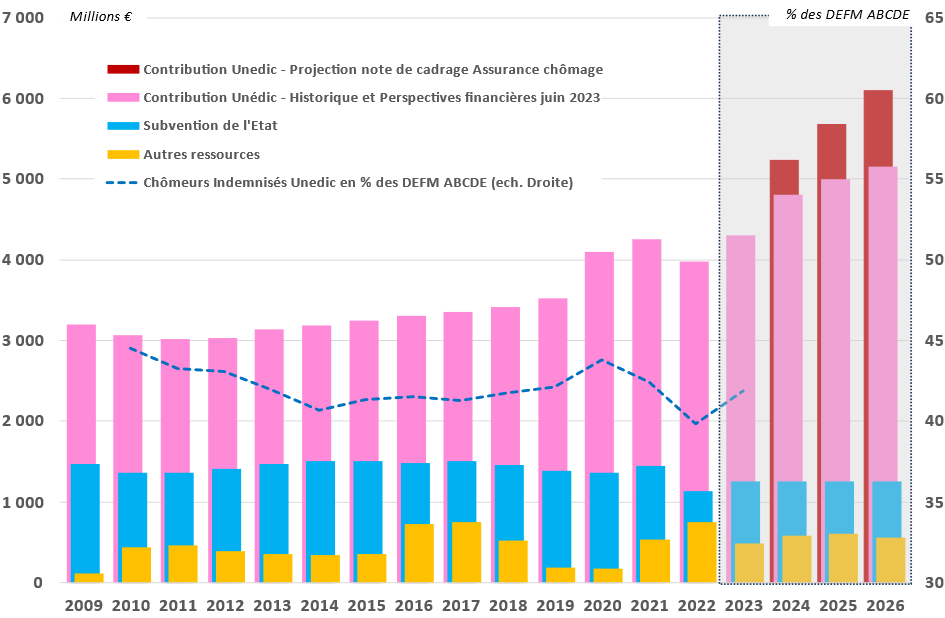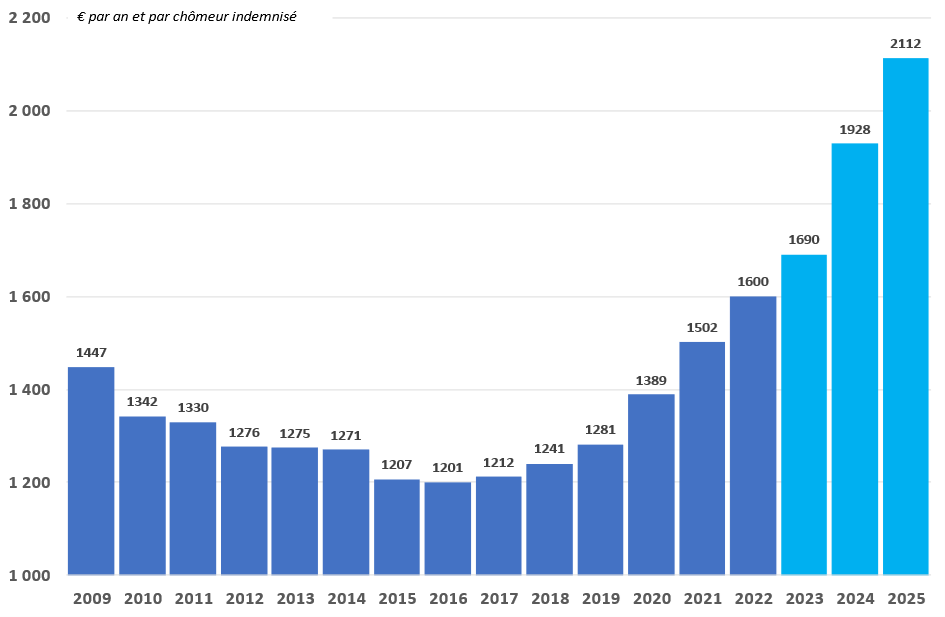Un second moment hamiltonien
par Hubert Kempf
Dans le débat européen autour du plan Next Generation EU, la décision de 2020 de la Commission européenne d’émettre de la dette au profit des États membres est souvent rapprochée de la décision de l’État fédéral américain de 1790, sous l’impulsion du secrétaire au Trésor Alexander Hamilton, non seulement d’honorer la dette fédérale en cours mais aussi d’assumer les dettes des États fédérés. Ce rapprochement est spécieux. La politique financière d’Hamilton est allée de pair avec la capacité à lever les impôts nécessaires au service de la dette, rendue possible par l’usage de la force militaire. La différence est patente avec la situation de l’Union européenne où la Commission est dépourvue de toute capacité coercitive.
La décision du Conseil européen (du 21 juin 2020, confirmée le 14 décembre 2020) d’autoriser la Commission européenne à répondre à la crise ouverte par la pandémie de Covid-19 par un programme d’émission de dette pour un montant de 750 milliards assumé par le budget de l’Union européenne afin de prêter à taux faible ou d’effectuer des transferts sans contrepartie aux États membres représente une innovation politique et économique qu’il est difficile de sous-estimer et impossible de négliger. Beaucoup de commentateurs ont voulu y voir le « moment hamiltonien » de l’Union européenne. L’expression a été prononcée en 2011 par Paul Volcker, ancien président de la Réserve fédérale américaine de 1979 à 1983 et alors président du Economic Recovery Advisory Board, nommé par Barack Obama. En référence avec la situation européenne, Paul Volcker déclara « Europe is at an Alexander Hamilton moment, but there’s no Alexander Hamilton in sight »[1].
L’expression a fait florès et a été reprise par de nombreux commentateurs, journalistes ou politiques. Elle fait référence à la politique budgétaire et fiscale proposée, négociée et appliquée par Alexander Hamilton en 1790[2]. Nommé par George Washington secrétaire au Trésor le 11 septembre 1789, après la création de cette fonction par le Congrès le 2 septembre, Hamilton s’attela immédiatement à la rédaction d’un rapport qui fit date dans l’histoire américaine. Hamilton proposait dans ce rapport[3] de ne pas faire défaut sur la dette fédérale en cours, d’appliquer le même traitement à tous les détenteurs de titres de la dette fédérale, indépendamment de la date à laquelle ils avaient été acquis, et de transférer les dettes en cours des États fédérés à l’État fédéral.
Les experts discutent de la pertinence du parallèle établi entre la décision sur les finances publiques fédérales prise par le Congrès américain en 1790 et les annonces faites par la Commission européenne en 2020. Ils concluent que les programmes et les circonstances diffèrent substantiellement au point de vider de sens le parallèle établi[4]. Ces discussions, centrées sur des considérations économiques, sont utiles. Mais elles manquent l’essentiel, l’impact politique de ces actes.
Pour ce qui est de la politique fiscale et financière d’Alexander Hamilton, son importance dans l’histoire politique américaine n’est disputée par personne. Cette importance s’explique par trois raisons :
1/ le redressement immédiat et spectaculaire du crédit de l’État fédéral et des États fédérés américains sur les marchés financiers internationaux ;
2/ La structuration du débat politique américain entre les fédéralistes et les républicains, qui continue de nos jours où les références aux traditions hamiltonienne et jeffersonienne restent vivaces[5] ;
3/ la puissance intellectuelle d’Hamilton qui l’amène à développer une analyse du fonctionnement des marchés financiers très en avance sur son temps[6].
Pour ce qui est de la signification qu’il faut accorder aux annonces des autorités européennes, au risque d’être démenti par les développements futurs, avançons qu’il est pertinent de voir dans ces annonces une innovation évidente : il est maintenant ouvertement admis par tous les pays de l’Union européenne que la Commission européenne peut exercer un pouvoir budgétaire important en cas de circonstances exceptionnelles (sans que soient véritablement définies ce que sont de telles circonstances). De plus, le principe de conditionnalité de l’aide apportée aux États membres est également entériné par le Conseil européen, ce qui place manifestement la Commission européenne en situation d’arbitre et la dote d’un pouvoir discrétionnaire vis-à-vis des États. Mais ces évolutions sont davantage des expédients et ne se traduisent pas par une modification dans les rapports institutionnels de pouvoir entre les États et les instances de l’Union (les autorités européennes)
Dans cette perspective, il est raisonnable de se référer au moment hamiltonien de 1790 pour juger de l’innovation que représenterait la décision de 2020. Dans les deux cas, il y a une décision budgétaire qui modifie les rapports financiers entre les juridictions membres des unions. Plus précisément, l’échelon fédéral dans le cas américain, supra-étatique dans le cas européen assume des charges qui incombaient ou auraient pu incomber aux juridictions étatiques de l’union. On pressent que cette opportunité ne peut qu’impliquer une modification importante, voire radicale, des rapports politiques entre juridictions.
Mais ce seul point de comparaison ne suffit pas. Si le programme fiscal et financier d’Hamilton a eu le succès incontestable qu’on lui reconnaît, cela n’est pas dû au seul passage de la loi ni à sa traduction en des réglementations financières complexes.
Pour le comprendre, il faut singulariser un second « moment hamiltonien ». Celui-ci se situe en 1794 lors de la « rébellion du whiskey » qui secoue l’ouest des 13 États américains qui constituent alors les États-Unis[7].
Cette rébellion[8] est issue de la loi votée par le Congrès en 1789 édictant que des droits d’accise pouvaient être levés par l’État fédéral. Notons immédiatement la différence avec le cas européen : à peine la Constitution adoptée (après la ratification de 9 des 13 États américains existant alors), le premier Congrès exerce son droit à lever l’impôt qui lui est accordé par la Constitution, à la différence de ce que prévoyaient les Articles de la confédération. Ce droit dont ne dispose pas le parlement européen, ni a fortiori la Commission. Dès 1790, Hamilton proposa de lever une taxe sur le whiskey. Ce choix était logique : le whiskey est un produit de choix pour lever un impôt dans un temps où les voies de communication sont difficiles et les échanges commerciaux internes à l’Union, limités : produit non-périssable et transportable, il concentre en un petit volume une production agricole importante mais périssable et s’échange facilement. De plus, il est facile à contrôler – et donc à imposer – car les points de passage sont peu nombreux. Mais sa production est concentrée dans quelques comtés de l’ouest de quelques États alors qu’il est consommé dans l’ensemble du territoire. L’impôt envisagé fut donc considéré par les producteurs de whiskey comme une discrimination importante à leur encontre puisqu’ils seraient les seuls à le supporter au profit de l’Union tout entière. Le Congrès, conscient du problème que cela créait, refusa de voter la loi. Il la vota pourtant l’année suivante, soit un an après la loi sur la régularisation des dettes publiques, devant la nécessité de remplir les caisses de l’État fédéral, en particulier pour assumer la charge de la dette fédérale alourdie par sa décision de 1790.
Les désordres ne tardèrent pas à s’installer à partir de 1791, surtout dans les comtés de l’ouest de la Pennsylvanie, encouragés par les opposants au parti fédéraliste conduit par Hamilton. Les tensions devinrent vite une affaire politique, opposant les fédéralistes, partisans d’un État fort et interventionniste, contrôlé par les élites sociales et instruites, et les anti-fédéralistes, qui allaient former le noyau du parti républicain mené par Jefferson. Les premiers, au pouvoir, estimèrent que l’autorité de l’État (fédéral) était en cause et qu’il s’agissait d’un prodrome du retour à l’anarchie qui prévalait avant le vote de la Constitution de 1789. Il devenait selon Hamilton urgent d’agir contre les rebelles mais Georges Washington, président et en tant que tel, chef des armées, temporisa.
En août 1794, le refus de l’impôt mena près de 6 000 opposants en arme à se mobiliser. Ils furent bientôt sur le point de prendre le contrôle de Pittsburgh. Après l’échec d’une énième tentative de conciliation, Washington prit alors la décision d’intervenir militairement contre les rebelles. Il ordonna la levée de 14 000 miliciens, venus de New Jersey, du Maryland, de Virginie et de Pennsylvanie. Devant un tel déploiement de force (plus important que l’armée continentale qui avait tenu tête aux Britanniques), la rébellion s’effondra immédiatement. Les rebelles se dispersèrent. Les meneurs furent arrêtés et jugés. Deux furent condamnés à la pendaison et finalement graciés par Washington. La conclusion de l’affaire fut tirée par Hamilton : « L’insurrection au final nous aura profité et ajoute à la solidité de toute chose dans ce pays »[9]. C’était particulièrement vrai pour la solidité financière de l’État fédéral.
Ce second moment éclaire et complète le premier moment de 1790, celui de la rédaction du rapport d’Hamilton, puis de l’adoption de la loi qu’il soumet au Congrès. Deux raisons expliquent la promptitude et la détermination avec lesquelles Hamilton conçoit sa politique budgétaire et financière, outre la situation financière catastrophique dans laquelle se trouve la jeune république dont le crédit est alors au plus bas. La première, reconnue par tous, historiens, professionnels de la finance et politiques, est son expertise en ces matières, exceptionnelle pour l’époque, qui lui fait concevoir un plan audacieux et complexe. Ce plan fut peu, voire pas du tout, compris par ses contemporains et en particulier ses opposants, John Adams et Thomas Jefferson en tête, mais il l’est aisément de nos jours où il est reconnu que la crédibilité financière (définie comme la cohérence temporelle d’un plan d’endettement) est un élément central dans la détermination des taux d’intérêt. La seconde, tout aussi importante, est qu’il estime être capable de disposer des revenus fiscaux nécessaires pour assurer le service de la dette. Ce qui implique de pouvoir lever effectivement l’impôt. Hamilton fut un brillant officier de la guerre d’indépendance, remarqué par Washington pour sa bravoure et son intelligence militaire au point qu’il en fit son aide de camp et put ainsi mesurer ses qualités intellectuelles, politiques et militaires. Hamilton connaît le pouvoir des canons[10] autant que le poids des mots. Face à la rébellion fiscale, il n’hésite pas à plaider pour l’exercice du monopole de la violence légitime dont dispose l’État fédéral et convainc le président de mater la rébellion de l’Ouest.
Ce second moment de la fin du XVIIIe est exemplaire de la capacité de l’État fédéral américain naissant de boucler son budget, d’assurer le service de sa dette, même augmentée des dettes des États et donc d’éviter le défaut de paiement. Sans cette capacité, il est douteux que le coup de génie tenté par Hamilton en 1790 eût si bien réussi.
Cet épisode met cruellement en lumière la différence avec la situation européenne des années 2020. À aucun moment, et pour cause, la Présidente de la Commission n’a évoqué clairement la façon dont la dette émise serait remboursée. A fortiori elle n’a pu déclarer que l’Union européenne lèverait des impôts, elle n’en a pas le pouvoir, ni qu’elle mobiliserait si nécessaire les moyens de coercition et de contrainte sur les Européens récalcitrants puisqu’elle n’en a aucun à sa disposition.
On comprend que les « fédéralistes » européens (appelons ainsi les partisans d’institutions européennes supranationales fortes, faute d’une meilleure appellation) se soient emparés de l’expression de « moment hamiltonien » pour qualifier l’adoption par la Commission européenne de son plan de relance. Se placer sous le patronage prestigieux de Hamilton, rapprocher ce plan des propositions faites au Congrès en 1790 et défendues avec brio par Hamilton permet de laisser entendre que l’Union européenne suit à plus de deux siècles de distance un chemin assez similaire à celui que s’est fait la république américaine, à savoir la constitution progressive mais obstinée d’une fédération, d’un ensemble inter-gouvernemental hiérarchisé dominé par l’État fédéral. Mais c’est prendre bien des libertés avec l’histoire et se payer de mots plus que de réalité.
L’histoire de l’union américaine est bien différente de l’histoire de l’union européenne. L’union américaine est née en 1787-1789 de la constatation de l’impéritie de la confédération née en 1776, due à l’incapacité des États américains de coopérer efficacement. Elle s’est caractérisée dès son origine par une volonté de prééminence de l’État fédéral. Celle-ci a certainement mis du temps à s’établir et à exploiter toutes ses potentialités. Le rapport entre l’État fédéral et les États fédérés est toujours susceptible de varier. Actuellement, on assiste à une vague de promotion des États fédérés, voulue en particulier par l’actuelle Cour suprême. Mais de tels mouvements ne sont pas nouveaux et ne modifient pas significativement la domination politique, sociale et économique de l’État fédéral[11]. Cela ne peut nous surprendre : cette prééminence est inscrite dans les textes fondateurs de la république américaine et se lit dans les péripéties politiques de ses premières années comme le montrent clairement les politiques voulues et promues par le plus brillant et efficace de ses dirigeants, Alexander Hamilton. C’est bien ce que montrent les deux « moments hamiltoniens » des années 1790 qui ne peuvent être pensés l’un sans l’autre. Le premier moment hamiltonien incite à rapprocher la politique budgétaire américaine de la fin du XVIIIe siècle menée par Hamilton et les annonces européennes de 2020 en réaction à la pandémie de la Covid-19. Le second moment hamiltonien amène au contraire à mieux voir les différences entre les deux séquences, et à illustrer en quoi le fédéralisme américain n’est pas une préfiguration des évolutions de l’Union européenne. Les premières années de la république américaine, loin de mettre en évidence une congruence entre la destinée américaine et les tâtonnements européens, montrent plutôt leurs différences marquées. La construction européenne n’a rien à voir avec la fondation des États-Unis et ne suit pas les voies fédéralistes suivies par ceux-ci.
Bref, un moment ne suffit pas pour faire une histoire. Les dirigeants et les citoyens européens seraient bien avisés de ne pas oublier cette leçon tirée des débuts de la fédération américaine.
[1] Voir Wheatley (2012), « Analysis: What Europe can learn from Alexander Hamilton ». Reuters.
[2]La biographie de référence sur Hamilton est celle issue de Chesnow, Ron (2005), Alexander Hamilton, Penguin Books.
[3] Hamilton Alexander (1790), Report Relative to a Provision for the Support of Public Credit, U.S. Treasury Department.
[4]Voir en particulier la contribution très fine d’Elie Cohen (2020). Voir également Issing (2020) et Gheorghiu (2022).
[5] Voir Banning, Lance (1980), The Jeffersonian persuasion: Evolution of a party ideology. Cornell University Press.
[6] Thomas Sargent (2012) n’a ainsi aucun mal à interpréter la pensée et l’action d’Hamilton en des termes propres à la théorie économique la plus récente, issue de la révolution des anticipations rationnelles et de la notion de cohérence temporelle.
[8]Nous suivons les développements consacrés à la rébellion par Gordon S. Wood (2009), Empire of liberty. A history of the Early Republic, 1789-1815, Oxford University Press, pp. 134-139
[9]Alexander Hamilton à Angelica Church, 23 octobre 1794, Papers of Alexander Hamilton, Vol. 17, p.340. Cité par Wood (2009), p.138.
[10]« Ultima ratio regum », comme d’autres avant lui l’avait reconnu.
[11]C’est déjà la thèse que je défendais dans les années 1980, preuve que la question n’est pas nouvelle. Cf. Kempf et Toinet (1980).